Résumé
Voici une réflexion audacieuse de l’instance organisatrice (échappant à la pondération qui caractérise les enseignants chercheurs reconnus en sciences de gestion). Elle suggère qu’en matière de management il faudrait peut-être penser autrement et mieux en épousant moins rôles et fonctions :
" Ce texte ne se présente assurément pas comme un exercice académique. L'auteur a une autre ambition : celle d'inviter le lecteur, dans une poétique qui lui est propre, à rechercher la pierre précieuse de la Pertinence. Il nous rappelle que la libération des systèmes ne peut faire l'économie d'un questionnement personnel sur le fonctionnement de son propre esprit. Il nous place en bonne compagnie pour définir le travail (méditatif) de désaliénation fondamentale à accomplir. Il s'agit d'affiner son discernement, de saisir que la liberté du philosophe se trouve ailleurs que dans nos aspirations égotiques. Les occasions sont trop rares pour ne pas demander à l'auteur de continuer à nous autoriser à cheminer avec lui. Les lecteurs que nous sommes pourraient tirer "grand profit du soin qu'il prendrait à le faire."
Mots clefs : Profit, totalitarisme organisationnel, soin de soi et d’autrui, exactitude, choix.
" Ce texte ne se présente assurément pas comme un exercice académique. L'auteur a une autre ambition : celle d'inviter le lecteur, dans une poétique qui lui est propre, à rechercher la pierre précieuse de la Pertinence. Il nous rappelle que la libération des systèmes ne peut faire l'économie d'un questionnement personnel sur le fonctionnement de son propre esprit. Il nous place en bonne compagnie pour définir le travail (méditatif) de désaliénation fondamentale à accomplir. Il s'agit d'affiner son discernement, de saisir que la liberté du philosophe se trouve ailleurs que dans nos aspirations égotiques. Les occasions sont trop rares pour ne pas demander à l'auteur de continuer à nous autoriser à cheminer avec lui. Les lecteurs que nous sommes pourraient tirer "grand profit du soin qu'il prendrait à le faire."
Mots clefs : Profit, totalitarisme organisationnel, soin de soi et d’autrui, exactitude, choix.
Nous allons poursuivre dans le droit fil de cette originalité libertaire...
Il faut ici prendre une position subjective d’auteur libre de ses choix. J’ai la conviction que l’utilitarisme de plus en plus impatient, opportuniste et soucieux de cumuls rentables efface sournoisement les lenteurs de la Pertinence avec une systématisation discrète, violente et totalitaire.
Une caste dominante émergente, s’appuyant sur les nouvelles technologies mondialisées de communication, assoit son pouvoir par un détournement utilitaire du savoir et des compétences. Elle « artificialise » la motivation autour de l’efficacité opérationnelle devenant compétitive aux dépens du plaisir libre et singulier de faire, d’imaginer et de partager. Elle accapare l’information pour instaurer le totalitarisme du productivisme et des monopoles commerciaux. Elle pénètre insidieusement l’intime de chacun par les espaces médiatiques confiscatoires de l’image télévisuelle et de l’internet qui saturent la capacité d’attention et dévoient le temps de la réflexion.
La répétition « conditionnante » et la contrainte d’écoute, comme le contrôle des réseaux sociaux par les fournisseurs d’accès, font un formidable outil de propagande. Les oligarchies, nées des concentrations boursières spéculatives, constituent une nouvelle noblesse qui n’a même plus besoin de confrontation militaires territoriales ou d’expansion coloniale. Portefeuille d’actions fait foi et titre.
L’exécution opérationnelle se fait de manière indifférenciée, au moindre coût devenu stratégie, par les « gagne petit » de tous pays. Les cadres, « préformatés » par maintes écoles formant à la pensée efficace et rentable, sont réduits à la docilité dans leur compétence cloisonnée et le contrôle mutuel suspicieux des groupes de travail jaloux faisant peu équipe.
L’éthique est devenue avant tout maîtrise des coûts de production associée à l’évitement des tensions et des déperditions d’énergie liées au facteur humain. L’hyper responsabilisation qu’induisent la norme, l’évaluation et la statistique, renforcée d’entretiens de contrôle sournoisement policiers, jugule l’indépendance d’esprit. L’autonomie apparente qui se délègue n’est que tactique de management visant à extraire quelques plus-values latentes des inquiétudes et des passions du sujet.
La réflexion sur l’humain, focalisée aujourd’hui autour du management et des thérapies dans leurs utilitarismes, s’est écarté des besoins essentiels du psychisme qui ont peu varié depuis la préhistoire, même s’ils se sont dévoyés lors de l’époque encore proche du néolithique avec la propriété, la productivité, le commerce et l’esclavage dont nous vivons encore les effets productifs de la conjugaison.
Une caste dominante émergente, s’appuyant sur les nouvelles technologies mondialisées de communication, assoit son pouvoir par un détournement utilitaire du savoir et des compétences. Elle « artificialise » la motivation autour de l’efficacité opérationnelle devenant compétitive aux dépens du plaisir libre et singulier de faire, d’imaginer et de partager. Elle accapare l’information pour instaurer le totalitarisme du productivisme et des monopoles commerciaux. Elle pénètre insidieusement l’intime de chacun par les espaces médiatiques confiscatoires de l’image télévisuelle et de l’internet qui saturent la capacité d’attention et dévoient le temps de la réflexion.
La répétition « conditionnante » et la contrainte d’écoute, comme le contrôle des réseaux sociaux par les fournisseurs d’accès, font un formidable outil de propagande. Les oligarchies, nées des concentrations boursières spéculatives, constituent une nouvelle noblesse qui n’a même plus besoin de confrontation militaires territoriales ou d’expansion coloniale. Portefeuille d’actions fait foi et titre.
L’exécution opérationnelle se fait de manière indifférenciée, au moindre coût devenu stratégie, par les « gagne petit » de tous pays. Les cadres, « préformatés » par maintes écoles formant à la pensée efficace et rentable, sont réduits à la docilité dans leur compétence cloisonnée et le contrôle mutuel suspicieux des groupes de travail jaloux faisant peu équipe.
L’éthique est devenue avant tout maîtrise des coûts de production associée à l’évitement des tensions et des déperditions d’énergie liées au facteur humain. L’hyper responsabilisation qu’induisent la norme, l’évaluation et la statistique, renforcée d’entretiens de contrôle sournoisement policiers, jugule l’indépendance d’esprit. L’autonomie apparente qui se délègue n’est que tactique de management visant à extraire quelques plus-values latentes des inquiétudes et des passions du sujet.
La réflexion sur l’humain, focalisée aujourd’hui autour du management et des thérapies dans leurs utilitarismes, s’est écarté des besoins essentiels du psychisme qui ont peu varié depuis la préhistoire, même s’ils se sont dévoyés lors de l’époque encore proche du néolithique avec la propriété, la productivité, le commerce et l’esclavage dont nous vivons encore les effets productifs de la conjugaison.
Aux antipodes de ce monde hyper moderne en expansion, je fus responsable (dûment qualifié) d’établissements marginaux accueillant des adolescents et de jeunes adultes en déshérence, en errance et souvent en délinquance. Il me fallut un certain partage des révoltes singulières de ces « bénéficiaires » pour diriger en liberté et sécurité suffisantes ces institutions hors limites, mais paradoxalement assignées (comme toute organisation de notre temps) par la loi et la règle à l’ultime logique de la statistique, du nombre et du résultat.
Nous sommes théoriquement partout dans ce que Voltaire définissait comme le meilleur des mondes raisonnés possibles où tout irait évidemment pour le mieux. Faute de gérer, l’œil rivé sur la bonne forme procédurale, je fus aventureux. Cette résistance passait pour moi par l’introduction de variables incongrues dans l’institution comme le jardin, le poulailler, le théâtre et la randonnée, lieux d’un certain désordre où l’humain trouve ses équilibres hasardeux hors des cadres réglementaires dans des formats improbables à inventer ensemble. L’harmonie advenait dans les moments où l’on avait su s’étonner mutuellement.
Nous sommes théoriquement partout dans ce que Voltaire définissait comme le meilleur des mondes raisonnés possibles où tout irait évidemment pour le mieux. Faute de gérer, l’œil rivé sur la bonne forme procédurale, je fus aventureux. Cette résistance passait pour moi par l’introduction de variables incongrues dans l’institution comme le jardin, le poulailler, le théâtre et la randonnée, lieux d’un certain désordre où l’humain trouve ses équilibres hasardeux hors des cadres réglementaires dans des formats improbables à inventer ensemble. L’harmonie advenait dans les moments où l’on avait su s’étonner mutuellement.
Tout propos organisationnel fait aujourd’hui à priori psychologisme prétentieux et technicité absolutiste suffisante. Le professionnel prend à la lettre ses fonctions de manager ou de psychologue au point de s’y forger une identité narcissique savante par un surcroît d’aliénation induit par l’emprise institutionnelle. Sans aller jusqu’à l’extrême, qui fit servir inconditionnellement maintes personnes honnêtes pour des systèmes totalitaires quasi criminels, on voit bien des individus, possédés par leur rôle, soutenir jusqu’à l’absurde la consigne et le projet. Ce formalisme développe une absence récurrente de poésie et rien ne fait métaphore tierce permettant le partage. Ce désastre du symbolique et de l’imaginaire mené à son terme devient violence. La perversion finit par s’instaurer comme modalité relationnelle ordinaire.
On pourrait espérer un recours dans l’éducation et la culture. Mais formations et université adoubent exclusivement et inconditionnellement la compétence scolastique et le discours univoque du savoir, dûment référencé. Il devient dogme quasi religieux dans un formalisme scrupuleux détenu par la caste des scribes titrés qui paradent en université mieux que ne le faisaient les généraux d’antan. Les locaux hygiéniques, les réunions aseptisées et le temps de plus en plus compté génèrent une forme réglementaire de pratique gestionnaire uniformisatrice. Sous les apparences d’intentions hautement sociales, affichées dans le discours politique toujours correct, elle ne se sait en rien totalitaire. Un cadrage institutionnel prédéfini affiche une prétention de démocratie. Certes, toute intelligence avisée la trouve suspecte par la systématisation de cet affichage où les prétentions éthiques sonnent creux. Cet irréalisme surhumain post moderne, aux prétentions savantes et aux appâts technologiques séducteurs, est d’une vacuité angoissante pour tout esprit curieux aimant à se donner un espace personnel de liberté. Le mythe et le rêve n’y ont aucune place. Le jeu social, devenu réel, et même hyper réel par sa pratique surréaliste et impersonnelle du mesurable, rend sans doute davantage fou que les anciennes emprises où l’on connaissait les maîtres et leur cruauté…
Les conservateurs « réactionnaires » déterminés, les progressistes, rêveurs innocents que l’on abuse sans peine, les paresseux de nature, les malhonnêtes, les arrivistes et les simples imbéciles (cumuls possibles !) s’attachent à divers titres à l’entretien de ce jeu truqué où ils trouvent souvent leurs niches quelquefois opportunes et toujours symptomatiques de profit et de jouissance.
Les conservateurs « réactionnaires » déterminés, les progressistes, rêveurs innocents que l’on abuse sans peine, les paresseux de nature, les malhonnêtes, les arrivistes et les simples imbéciles (cumuls possibles !) s’attachent à divers titres à l’entretien de ce jeu truqué où ils trouvent souvent leurs niches quelquefois opportunes et toujours symptomatiques de profit et de jouissance.
Que sommes nous en fait ? La science n’aime que la perfection des hypothèses matérialistes excluant l’aléatoire. Mais nul ne peut se targuer d’échapper à l’indétermination et à l’ambivalence. Face à toute situation, tout objet ou toute personne, un certain nombre de choix latents, plus ou moins conscients, nous portent à « tirer profit » ou à « prendre soin ». Une oscillation entre les deux versants, échappant à toute mesure et tout jugement serein, vient se glisser dans cette faille où le sujet ignore ce qui le pousse. Mais il suffit de se rendre davantage attentif à ses motivations intimes pour savoir vers quelle tendance on incline. Nulle école n’enseigne, ni même ne suggère, ce travail sur soi-même qui élève (un peu) au-dessus des passions déraisonnables et de leurs mises en acte compulsives.
Dès que l’on échappe au totalitarisme pulsionnel des tentations de tous ordres et aux multiples conditionnements sociaux, on découvre un espace étonnant de liberté d’être d’où s’effacent les inquiétudes d’évaluation, d’image et les soucis de conformité. On écarte même la jouissance toujours douteuse du rapport à autrui dans la déclinaison de ses ambivalences. Il importe peu de profiter en prédateur de quelques faiblesses que l’on discerne, ou de tenter de secourir en bienfaiteur inconditionnellement généreux. On se retrouve au-delà du monde foisonnant d’imbéciles à principes, de rêveurs impénitents, de salauds ordinaires, d’hypocrites trompeurs, de violents sanguins et de petits docteurs suffisants. Nous voici même réfutant le combien ? et le quand ? impérieux de l’économisme avide et impatient. Nous voici seulement pris par une intelligence vigilante sur la qualité de réponse où le signifiant fera sens partageable.
Nul besoin ici de s’ériger à priori en moraliste, de se vouloir philosophe ou de s’adonner à la leçon savante. L’esprit se libère des tentations pulsionnelles prédatrices, de ses complaisances narcissiques et des compulsions naïves. Totalement présent dans sa réflexion, il ne guette ni le regard de la foule, ni l’empressement des avis. Les conséquences même de ce qu’il va énoncer lui indifférent. C’est ici qu’il faut rencontrer Socrate traquant en chacun l’exactitude de l’énonciation et Diogène signifiant le dérisoire de toute prétention tirée de la position, du statut ou de l’habit.
Le monde obsédé d’organisation, de titres, de références et bardé de niches claniques rassurantes devient sujet d’étonnement lorsque l’on découvre la liberté en soi-même. L’humoriste qui caricature les postures sociales et politiques sur scène nous fait rire aux éclats. On franchit alors le cap paralysant de la crainte obscure des pouvoirs. Les plus audacieux d’entre nous deviennent maîtres de leurs choix avec une autonomie et une responsabilité sans cesse croissante échappant aux objets, aux contingences et aux pressions. Les ressentis et les émotions s’incorporent dans les postures et les actions. Certes il y a toujours un brin de calcul d’opportunité et quelques réserves de prudence, mais cela s’inclut dans la nécessité première de pertinence.
Dès que l’on échappe au totalitarisme pulsionnel des tentations de tous ordres et aux multiples conditionnements sociaux, on découvre un espace étonnant de liberté d’être d’où s’effacent les inquiétudes d’évaluation, d’image et les soucis de conformité. On écarte même la jouissance toujours douteuse du rapport à autrui dans la déclinaison de ses ambivalences. Il importe peu de profiter en prédateur de quelques faiblesses que l’on discerne, ou de tenter de secourir en bienfaiteur inconditionnellement généreux. On se retrouve au-delà du monde foisonnant d’imbéciles à principes, de rêveurs impénitents, de salauds ordinaires, d’hypocrites trompeurs, de violents sanguins et de petits docteurs suffisants. Nous voici même réfutant le combien ? et le quand ? impérieux de l’économisme avide et impatient. Nous voici seulement pris par une intelligence vigilante sur la qualité de réponse où le signifiant fera sens partageable.
Nul besoin ici de s’ériger à priori en moraliste, de se vouloir philosophe ou de s’adonner à la leçon savante. L’esprit se libère des tentations pulsionnelles prédatrices, de ses complaisances narcissiques et des compulsions naïves. Totalement présent dans sa réflexion, il ne guette ni le regard de la foule, ni l’empressement des avis. Les conséquences même de ce qu’il va énoncer lui indifférent. C’est ici qu’il faut rencontrer Socrate traquant en chacun l’exactitude de l’énonciation et Diogène signifiant le dérisoire de toute prétention tirée de la position, du statut ou de l’habit.
Le monde obsédé d’organisation, de titres, de références et bardé de niches claniques rassurantes devient sujet d’étonnement lorsque l’on découvre la liberté en soi-même. L’humoriste qui caricature les postures sociales et politiques sur scène nous fait rire aux éclats. On franchit alors le cap paralysant de la crainte obscure des pouvoirs. Les plus audacieux d’entre nous deviennent maîtres de leurs choix avec une autonomie et une responsabilité sans cesse croissante échappant aux objets, aux contingences et aux pressions. Les ressentis et les émotions s’incorporent dans les postures et les actions. Certes il y a toujours un brin de calcul d’opportunité et quelques réserves de prudence, mais cela s’inclut dans la nécessité première de pertinence.
Parvenus là, il est vain et dérisoire de vouloir s’afficher sage ou compétent. On redécouvre la posture socratique qui signifie l’exactitude ici et maintenant dans l’émergence du partage intelligent de la réalité entre humains, sans jalousie et sans violence. Il serait aussi sot de faire étalage de cette exactitude que de se l’accaparer pour en rédiger de pesants mémoires. La liberté est une pratique immanente bien plus qu’un sujet de thèse. Mais son émergence est fragile et toujours menacée. Les pouvoirs organisés traquent l’indépendance d’esprit qui trouble tout système constitué, empâté dans ses appétits immodérés et farouches, comme assujetti à ses gardiens devenant dangereux dans le heurt incessant des jalousies internes.
L’organisation finit par exister pour elle-même. Elle générait jadis les monstres militaro-concentrationnaires. Aujourd’hui apparaissent les super créatures financières usant de fonds monétaires artificiels. Leur puissance destructrice efface celle des meilleures bombes. Il n’est même pas certain que les créateurs et les manipulateurs de l’argent fou en soient vraiment maîtres. Les crises en témoignent lorsque s’effondrent les promesses virtuelles du crédit et de l’objet devenu leurre spéculatif.
L’organisation finit par exister pour elle-même. Elle générait jadis les monstres militaro-concentrationnaires. Aujourd’hui apparaissent les super créatures financières usant de fonds monétaires artificiels. Leur puissance destructrice efface celle des meilleures bombes. Il n’est même pas certain que les créateurs et les manipulateurs de l’argent fou en soient vraiment maîtres. Les crises en témoignent lorsque s’effondrent les promesses virtuelles du crédit et de l’objet devenu leurre spéculatif.
Aucune entreprise ne saurait se déclarer libérée si elle n’est menée par un esprit libre osant s’exposer au-delà des pesanteurs en ne se justifiant que de sa seule exactitude. Cette liberté d’affirmation, sublimée jusqu’au détachement de toute contingence, est infiniment crédible et finit par se partager intimement par une majorité, sans insignes ni oriflammes. Il faut ici concevoir la pérennité de l’espèce par la résurgence incessante du bon sens. Tout politique la réfute au nom de ses postulats partisans temporels qu’il rend univoques, identitaires et confiscatoires. Cette liberté, sans hypothèques idéologiques, contourne l’ornière épistémologique de la doctrine routinière ou prédatrice dont se nourrit l’appareil organisationnel soucieux d’équilibre tautologique raisonné.
Mais elle ne saurait être qu’un phénomène local et temporel qui tient bien plus de l’aventure instantanée tenant du « hic et nunc » que d’une quelconque logique organisationnelle, éthique, politique ou économique. Socrate en fit la démonstration. Aristote donna (en tout solipsisme !) quelques espaces d’indépendance à la liberté de pensée. Nous en sommes encore un peu en deçà de la compréhension et de l’intelligence. Il faudrait relire les traces exemplaires que nous laissent (entre autres) Montaigne, Voltaire, Gide, Valéry et Gandhi. Mais personne ne décrypte au quotidien, et encore moins n’enseigne, ce langage de l’esprit créatif et libertaire, sautant au-dessus des bénéfices immédiats, manifestes et irréfutables des prises objectives de gain du présent. Qui-donc vise à multiplier la lucidité ordinaire et l’éveil au qualitatif chez nos étudiants assujettis et conformés à l’hyper compétence dans l’hyperspécialisation ?
Dans tout système organisé chacun est soumis à la tentation pulsionnelle et impérieuse du passage à l’acte. Il faut se prouver et prouver selon les règles en place et les arbitrages sans appel. La mise en acte, devenue acte de foi du savoir, du pouvoir et du gain, induit une propension à l’emprise de soi sur autrui se donnant ses modalités et ses rites. Si l’acte est confronté à l’impossibilité ou à l’impuissance, le sujet quelque peu investi d’un rôle institutionnel se désagrège. La liberté ne saurait émerger, ni être assumée, sans un discours tiers, plus symbolique que raisonnable, qui la soutienne appelant inconditionnellement à la pensée désaliénée. Ce langage, tiers au-delà des enjeux, résulte d’un choix décisif et oblatif d’altérité et d’intelligence. Il donne les axes et les limites qui permettent de collectiviser l’activité en libre choix, en toute autonomie et responsabilité. Cette délégation libertaire est excessivement rare. On ne découvre pas plus un espace de liberté inconditionnelle dans le champ de l’humain qu’un pays de cocagne.
Mais elle ne saurait être qu’un phénomène local et temporel qui tient bien plus de l’aventure instantanée tenant du « hic et nunc » que d’une quelconque logique organisationnelle, éthique, politique ou économique. Socrate en fit la démonstration. Aristote donna (en tout solipsisme !) quelques espaces d’indépendance à la liberté de pensée. Nous en sommes encore un peu en deçà de la compréhension et de l’intelligence. Il faudrait relire les traces exemplaires que nous laissent (entre autres) Montaigne, Voltaire, Gide, Valéry et Gandhi. Mais personne ne décrypte au quotidien, et encore moins n’enseigne, ce langage de l’esprit créatif et libertaire, sautant au-dessus des bénéfices immédiats, manifestes et irréfutables des prises objectives de gain du présent. Qui-donc vise à multiplier la lucidité ordinaire et l’éveil au qualitatif chez nos étudiants assujettis et conformés à l’hyper compétence dans l’hyperspécialisation ?
Dans tout système organisé chacun est soumis à la tentation pulsionnelle et impérieuse du passage à l’acte. Il faut se prouver et prouver selon les règles en place et les arbitrages sans appel. La mise en acte, devenue acte de foi du savoir, du pouvoir et du gain, induit une propension à l’emprise de soi sur autrui se donnant ses modalités et ses rites. Si l’acte est confronté à l’impossibilité ou à l’impuissance, le sujet quelque peu investi d’un rôle institutionnel se désagrège. La liberté ne saurait émerger, ni être assumée, sans un discours tiers, plus symbolique que raisonnable, qui la soutienne appelant inconditionnellement à la pensée désaliénée. Ce langage, tiers au-delà des enjeux, résulte d’un choix décisif et oblatif d’altérité et d’intelligence. Il donne les axes et les limites qui permettent de collectiviser l’activité en libre choix, en toute autonomie et responsabilité. Cette délégation libertaire est excessivement rare. On ne découvre pas plus un espace de liberté inconditionnelle dans le champ de l’humain qu’un pays de cocagne.
Il est tentant de rêver pour les groupes et les institutions d’une « liberté » formelle instituée et réglementée qu’il importerait de partager. La liberté rêvée dans ses formes devient le plus souvent piège idéaliste pour soi et autrui dans l’emportement incontrôlable des passions où le souci d’ordre apporte par réaction les interdits obsessionnels. Dans le registre toujours étroit des applications, tout réformateur ou révolutionnaire mesure bientôt l’irréalisme de son rêve et la nécessité contraignante de décisions régulatrices violemment nécessaires, parfois cruelles et injustifiables. La liberté est d’abord discipline intime et singulière. Elle n’est pas effet de calcul ou projet collectif. Le libre partage de sens est toujours improbable. Les postures, les préjugés, les jalousies et les enjeux fondent dès la confrontation avec l’atmosphère sociale des résistances qui mènent aux rapports de force.
La liberté, comme l’exactitude, émerge dans son état natif avec l’immanence de l’énonciation. Rien n’est alors de l’ordre de la manipulation et d’une possible récupération. Sa pratique vise un « contenant symbolique » neuf absolument subjectif et n’appartenant à priori à personne. L’imaginaire s’y découvre ses espaces jubilatoires d’errance en en concevant simultanément les limites. Il serait dérisoire de conceptualiser là des définitions. C’est une « clinique » permanente de l’esprit du discours qui permet cette remise en question de soi. On la découvre avec le plus d’évidence dans l’improvisation théâtrale et la création artistique.
Le conceptuel établi dans ses déclinaisons convenues est souvent insuffisant, il peut même ne plus être nécessaire dans la majorité des situations. En deçà et au-delà de tout projet contingent, l’humain à d’abord un besoin permanent et urgent de signes. Main tendue, clin d’œil, petit cadeau symbolique ou sourire accompagnent aussi bien les plus hasardeuses montées au feu que les pires chutes. Bien souvent je ne fus manager que par cette présence complice.
Psychologue, je me crus rarement en pouvoir de guérisseur à système. Enseignant, j’appris à donner les règles et ouvroir un jeu où chacun avait le loisir de m’étonner. Il est probable que cela m’évita bien des soucis que rapportaient des collègues mieux besogneux. Il m’arriva même de découvrir avec plaisir le cadeau de quelques esprits créatifs. Mais même peu porté à élucider et conseiller, voire à usurper la souffrance et les impuissances d’autrui, il faut parfois questionner et dire sans crainte et en toute simplicité ce qui devient parfois d’évidence. Le praticien libre ne s’interdit pas la parole qui appelle le sens s’il sait taire ses manifestations intempestives de « sujet supposé savoir ». Cessant parfois d’être compétent, il se fait plus subtilement intelligent.
La liberté, comme l’exactitude, émerge dans son état natif avec l’immanence de l’énonciation. Rien n’est alors de l’ordre de la manipulation et d’une possible récupération. Sa pratique vise un « contenant symbolique » neuf absolument subjectif et n’appartenant à priori à personne. L’imaginaire s’y découvre ses espaces jubilatoires d’errance en en concevant simultanément les limites. Il serait dérisoire de conceptualiser là des définitions. C’est une « clinique » permanente de l’esprit du discours qui permet cette remise en question de soi. On la découvre avec le plus d’évidence dans l’improvisation théâtrale et la création artistique.
Le conceptuel établi dans ses déclinaisons convenues est souvent insuffisant, il peut même ne plus être nécessaire dans la majorité des situations. En deçà et au-delà de tout projet contingent, l’humain à d’abord un besoin permanent et urgent de signes. Main tendue, clin d’œil, petit cadeau symbolique ou sourire accompagnent aussi bien les plus hasardeuses montées au feu que les pires chutes. Bien souvent je ne fus manager que par cette présence complice.
Psychologue, je me crus rarement en pouvoir de guérisseur à système. Enseignant, j’appris à donner les règles et ouvroir un jeu où chacun avait le loisir de m’étonner. Il est probable que cela m’évita bien des soucis que rapportaient des collègues mieux besogneux. Il m’arriva même de découvrir avec plaisir le cadeau de quelques esprits créatifs. Mais même peu porté à élucider et conseiller, voire à usurper la souffrance et les impuissances d’autrui, il faut parfois questionner et dire sans crainte et en toute simplicité ce qui devient parfois d’évidence. Le praticien libre ne s’interdit pas la parole qui appelle le sens s’il sait taire ses manifestations intempestives de « sujet supposé savoir ». Cessant parfois d’être compétent, il se fait plus subtilement intelligent.
Le sujet demeure un terrain empirique et sauvage de bricolage pour les professionnels soucieux de le gérer ou de le réparer dans les règles de l’art, mais sans vrai talent. Cela ne va pas sans contradictions. Les thérapeutes bienveillants tendent le leurre du « lâcher prise » et les managers sérieux ceux de la « mise en acte efficace ». Mais ce « raisonnable » opportun ne saurait qu’entretenir la désorganisation d’une pensée souvent en faillite chez la plupart des patients (au sens de souffrants potentiels) ou des agents voués à l’hyper productivité.
La prothèse qu’apporte la « prise en charge » thérapeutique ou opérationnelle porte aux persévérances de pensée circulaire autour de la jouissance des symptômes se cristallisant enfin en plaintes. Certes on fidélise ainsi le patient et on asservit l’exécutant. La vieille collusion de la prêtrise et de la maitrise circonvenant l’individu est toujours opérante. Les écoles savent toujours en promouvoir la conjugaison raisonnable des pratiques. Mais le sujet, conformé et se croyant protégé, en est bien plus seul que jadis où les pouvoirs quasi magiques étaient quelque peu crédibles. Rien ne fait aujourd’hui promesse et n’efface en lui les espérances et les nostalgies héritées de son histoire. Il demeure encrypté dans le mythe de son drame infantile entre quelques éclairs de lucidité et d’humour.
Les bonnes intentions manifestes d’un monde organisationnel parfait visent à l’ordre « ménager » des choses et des pratiques. On prône l’égalitarisme de principe et le libre arbitre de chacun dans la contrainte d’exécution selon la norme et les délais. On se séduit de mots qui signifient de telles intentions honnêtes avant toute mise en œuvre. Mais la leçon sans complaisance de la réalité met bientôt cette perfection hypothétique en échec. Rien n’obéit scrupuleusement à la norme et ne répond exactement à l’évaluation. L’humain fonctionne dans un registre échappant aux perfections hypothétiques des technologies organisationnelles.
L’antagonisme latent et insidieux des désirs, se conjuguant aux appétits et aux passions, met vite en échec les intentions « inspirées » du management le mieux formé. La part humaine d’improvisations inventives vient alors parfois remédier à l’insuffisance de tout système. Il faut sans cesse une mise en pratique courageuse et hasardeuse de ce qui semble nécessaire et opportun au-delà de ce qui se pose comme défini, légitime et de droit. La remise en question des meilleurs principes d’autorisation ou de contrainte devient l’aléa douteux qu’affronte en toute prise de risque l’indépendance d’esprit.
La prothèse qu’apporte la « prise en charge » thérapeutique ou opérationnelle porte aux persévérances de pensée circulaire autour de la jouissance des symptômes se cristallisant enfin en plaintes. Certes on fidélise ainsi le patient et on asservit l’exécutant. La vieille collusion de la prêtrise et de la maitrise circonvenant l’individu est toujours opérante. Les écoles savent toujours en promouvoir la conjugaison raisonnable des pratiques. Mais le sujet, conformé et se croyant protégé, en est bien plus seul que jadis où les pouvoirs quasi magiques étaient quelque peu crédibles. Rien ne fait aujourd’hui promesse et n’efface en lui les espérances et les nostalgies héritées de son histoire. Il demeure encrypté dans le mythe de son drame infantile entre quelques éclairs de lucidité et d’humour.
Les bonnes intentions manifestes d’un monde organisationnel parfait visent à l’ordre « ménager » des choses et des pratiques. On prône l’égalitarisme de principe et le libre arbitre de chacun dans la contrainte d’exécution selon la norme et les délais. On se séduit de mots qui signifient de telles intentions honnêtes avant toute mise en œuvre. Mais la leçon sans complaisance de la réalité met bientôt cette perfection hypothétique en échec. Rien n’obéit scrupuleusement à la norme et ne répond exactement à l’évaluation. L’humain fonctionne dans un registre échappant aux perfections hypothétiques des technologies organisationnelles.
L’antagonisme latent et insidieux des désirs, se conjuguant aux appétits et aux passions, met vite en échec les intentions « inspirées » du management le mieux formé. La part humaine d’improvisations inventives vient alors parfois remédier à l’insuffisance de tout système. Il faut sans cesse une mise en pratique courageuse et hasardeuse de ce qui semble nécessaire et opportun au-delà de ce qui se pose comme défini, légitime et de droit. La remise en question des meilleurs principes d’autorisation ou de contrainte devient l’aléa douteux qu’affronte en toute prise de risque l’indépendance d’esprit.
C’est alors que la nécessité réactionnaire s’oppose à l’intention libertaire naissante. Le trop de liberté met en danger l’organisation et les individus. Dans les familles et les toute collectivité il importe qu’un ordre suffisant donne les codes et les modalités relationnelles. Certains doivent se faire gardiens du cadre et des buts. Tout système généreux, et même soucieux prioritairement d’éthique, demande sans cesse une réinvention des pratiques dans un contenant rigoureux faisant mieux bornes et référence, avant de figer la créativité constante du vivant.
Qui ose autoriser les émergences malicieuses et transgressives qui vont faire surprise créative ? C’est le rôle subversif d’Arlequin à la comédie. Il transcende celui du professeur, du matamore et du rêveur. C’est ici que le thérapeute et le manager dérogent et se discréditent. Il me fut souvent reproché de vouloir un nouvel état dans l’état. Les fonctions auxquelles je parvins ne furent jamais de celles où l’on prend un élan de carrière. Je fus candidat sans rivaux là où les sortants avaient abandonné toute espérance. Dans les conseils d’administration successifs que je connus je ne reçus d’appui amical que celui de deux colonels en retraite, sensibles aux défis. Le socialisme timoré et finalement prudent craignait mes audaces créatives. Il m’envoyait en désespoir de cause là où il savait son incapacité et son manque de courage. Mais le pire du possible dont on entretient le déni aujourd’hui est peut-être moins désastreux pour l’humain que la médiocrité raisonnable d’esprit.
Il importe de se vouloir parfois fou pour parvenir à être, à créer et à devenir. Tout délire (même malicieux et peut-être même délictueux !) est tentative, quelque peu teintée d’espérance, de restaurer une cohérence symbolique de pensée. C’est ici que l’audace constructive, allant vers quelque « ailleurs » encore indéfini, devient rare. Les « libérés » qui échappent aux systèmes et à la routine sont peu nombreux. On n’en rencontre quasiment jamais dans les castes des nantis, des promus et des élus prisonniers de leurs clans et des sectarismes ordinaires. L’appartenance légitimée passe toujours par l’inféodation aliénante.
Comme on le chantait pour les anarchistes « il en est un sur cent mais ils existent ! ». Ces fous qui traversent les seuils du convenu adviennent. Le concept de liberté n’a en lui-même intrinsèquement aucune valeur sans son émergence dans la personne. La fragilité et l’évanescence de la liberté amènent à lui accoler pour l’étayer la lourdeur de l’égalitarisme. On en sait la pratique improbable, parfaitement hasardeuse, précaire et risquée. Il faut également lui adjoindre la fraternité, dont on découvre avec l’expérience, l’ambivalence violente, source permanente de querelles à résonance intime, pires que celles qui résultent de la confrontation à la diversité sociale.
Qui ose autoriser les émergences malicieuses et transgressives qui vont faire surprise créative ? C’est le rôle subversif d’Arlequin à la comédie. Il transcende celui du professeur, du matamore et du rêveur. C’est ici que le thérapeute et le manager dérogent et se discréditent. Il me fut souvent reproché de vouloir un nouvel état dans l’état. Les fonctions auxquelles je parvins ne furent jamais de celles où l’on prend un élan de carrière. Je fus candidat sans rivaux là où les sortants avaient abandonné toute espérance. Dans les conseils d’administration successifs que je connus je ne reçus d’appui amical que celui de deux colonels en retraite, sensibles aux défis. Le socialisme timoré et finalement prudent craignait mes audaces créatives. Il m’envoyait en désespoir de cause là où il savait son incapacité et son manque de courage. Mais le pire du possible dont on entretient le déni aujourd’hui est peut-être moins désastreux pour l’humain que la médiocrité raisonnable d’esprit.
Il importe de se vouloir parfois fou pour parvenir à être, à créer et à devenir. Tout délire (même malicieux et peut-être même délictueux !) est tentative, quelque peu teintée d’espérance, de restaurer une cohérence symbolique de pensée. C’est ici que l’audace constructive, allant vers quelque « ailleurs » encore indéfini, devient rare. Les « libérés » qui échappent aux systèmes et à la routine sont peu nombreux. On n’en rencontre quasiment jamais dans les castes des nantis, des promus et des élus prisonniers de leurs clans et des sectarismes ordinaires. L’appartenance légitimée passe toujours par l’inféodation aliénante.
Comme on le chantait pour les anarchistes « il en est un sur cent mais ils existent ! ». Ces fous qui traversent les seuils du convenu adviennent. Le concept de liberté n’a en lui-même intrinsèquement aucune valeur sans son émergence dans la personne. La fragilité et l’évanescence de la liberté amènent à lui accoler pour l’étayer la lourdeur de l’égalitarisme. On en sait la pratique improbable, parfaitement hasardeuse, précaire et risquée. Il faut également lui adjoindre la fraternité, dont on découvre avec l’expérience, l’ambivalence violente, source permanente de querelles à résonance intime, pires que celles qui résultent de la confrontation à la diversité sociale.
Les modes immémoriaux de vie sociale, que certaines espèces animales pratiquent avec succès, montrent que la multitude se fédère un temps par la présence et la qualité de dominants reconnus parce qu’ils se sont imposés. La horde prend force et assure sa survie au travers des compétences pragmatiques du chef de meute du moment. En lui, chaque sujet retrouve ce besoin d’ordre symbolique et de ritualisation sécurisante qui fait nécessité. L’appartenance tend vers les protections d’avenir auxquelles le vivant spécifique est inconsciemment attaché, même s’il y déroge temporairement dans ses singularités.
Les groupes de primates, de loups et même les troupeaux de ruminants sauvages sont rapidement voués à la dispersion et à l’extinction lors des trop longues déshérences du pouvoir guide et organisateur d’une dominance parfois femelle. Le matriarcat, moins soucieux de compétitions dentées et cornées séductrices de prééminence sexuelle mâle printanière, conserve mieux les pérennités des liens, des pratiques et des parcours.
L’humanité d’aujourd’hui est moins exigeante que l’animal social. Elle se donne des chefs médiocres et des chefs fous au hasard de promotions sur titres ou élection. Parfois même elle s’illusionne sur les vertus hypothétiques de l’absence de chef. Mais sans une incarnation concrète, faisant nom, lignée, langage, tribu et appartenance, le sens des actes échappe peu à peu à l’individu dont le désir innomé se disperse dans l’indifférenciation du groupe désaxé. Cela fait cette errance dont Lacan disait avec ironie « les non dupes errent », libres certes, mais désorientés. L’illusion de liberté est proche de l’émergence du sentiment angoissé de solitude. La Fontaine nous signifia bien que les grenouilles ne renoncent jamais à se donner un roi. Les thérapeutes savent à quel point l’individu se soutient des menaces et des hostilités extérieures liées aux présences historiques tutélaires ou d’autorité immédiate devenues fantasmatiques. Le symptôme névrotique de sauvegarde qui nait là fait bouée de survie dans les naufrages mélancoliques de l’imaginaire. Vivre un conflit, un danger, une incertitude, voire même un harcèlement, tient en haleine et à l’écart de ce désastre du non-sens où se perd le gout de vivre.
Nous ignorons quels étaient les meneurs d’hommes de la préhistoire. Mais hors de la civilisation, dans les quelques derniers ilots subsistants de pensée sauvage, il est peu de chefs de village incompétents. Ce ne sont certes pas les « bons sauvages », dans l’état de nature supposé parfait, que voudraient trouver nos naïvetés écologistes et socialisantes. Mais sans doute les fermes garants d’une cohérence culturelle et symbolique rigoureuse entre le magique archaïque, le bon sens coutumier et les moyens du bord du jour, souvent expéditifs. Si l’espèce humaine a prospéré, elle le doit sans doute à des gouvernances de qualité ponctuées de choix décisionnels opportuns, irrévocables et parfois cruels.
Nos sociétés d’aujourd’hui feignent d’ignorer l’importance régulatrice de la sanction. Le romain disait : « qui aime bien châtie bien ». Tout parait réductible au partage rationnel convenable lors de réunions se voulant correctes, tolérantes, ouvertes et sans arrières pensées. Mais mener l’humain est une pratique sans innocence. Toute collectivité est un espace relationnel sous tension où fourmillent les conflits latents imminents et aux racines irréductibles sous les pétitions et les affrontements manifestes.
Les groupes de primates, de loups et même les troupeaux de ruminants sauvages sont rapidement voués à la dispersion et à l’extinction lors des trop longues déshérences du pouvoir guide et organisateur d’une dominance parfois femelle. Le matriarcat, moins soucieux de compétitions dentées et cornées séductrices de prééminence sexuelle mâle printanière, conserve mieux les pérennités des liens, des pratiques et des parcours.
L’humanité d’aujourd’hui est moins exigeante que l’animal social. Elle se donne des chefs médiocres et des chefs fous au hasard de promotions sur titres ou élection. Parfois même elle s’illusionne sur les vertus hypothétiques de l’absence de chef. Mais sans une incarnation concrète, faisant nom, lignée, langage, tribu et appartenance, le sens des actes échappe peu à peu à l’individu dont le désir innomé se disperse dans l’indifférenciation du groupe désaxé. Cela fait cette errance dont Lacan disait avec ironie « les non dupes errent », libres certes, mais désorientés. L’illusion de liberté est proche de l’émergence du sentiment angoissé de solitude. La Fontaine nous signifia bien que les grenouilles ne renoncent jamais à se donner un roi. Les thérapeutes savent à quel point l’individu se soutient des menaces et des hostilités extérieures liées aux présences historiques tutélaires ou d’autorité immédiate devenues fantasmatiques. Le symptôme névrotique de sauvegarde qui nait là fait bouée de survie dans les naufrages mélancoliques de l’imaginaire. Vivre un conflit, un danger, une incertitude, voire même un harcèlement, tient en haleine et à l’écart de ce désastre du non-sens où se perd le gout de vivre.
Nous ignorons quels étaient les meneurs d’hommes de la préhistoire. Mais hors de la civilisation, dans les quelques derniers ilots subsistants de pensée sauvage, il est peu de chefs de village incompétents. Ce ne sont certes pas les « bons sauvages », dans l’état de nature supposé parfait, que voudraient trouver nos naïvetés écologistes et socialisantes. Mais sans doute les fermes garants d’une cohérence culturelle et symbolique rigoureuse entre le magique archaïque, le bon sens coutumier et les moyens du bord du jour, souvent expéditifs. Si l’espèce humaine a prospéré, elle le doit sans doute à des gouvernances de qualité ponctuées de choix décisionnels opportuns, irrévocables et parfois cruels.
Nos sociétés d’aujourd’hui feignent d’ignorer l’importance régulatrice de la sanction. Le romain disait : « qui aime bien châtie bien ». Tout parait réductible au partage rationnel convenable lors de réunions se voulant correctes, tolérantes, ouvertes et sans arrières pensées. Mais mener l’humain est une pratique sans innocence. Toute collectivité est un espace relationnel sous tension où fourmillent les conflits latents imminents et aux racines irréductibles sous les pétitions et les affrontements manifestes.
Au-delà d’avoir raison et d’emporter la partie, il importe également là d’aimer ou d’être aimé et de s’en faire récit. Mais toute convergence finale demande à ce qu’il soit tranché aussi bien dans les ressentis que dans les visées personnelles. On ne saurait être aimé de tous ni pardonner par idéalisme ou principe. L’altérité demande une élaboration constante des rapports dans une évaluation tierce sans complaisance, ni rigidité, avec une aptitude des parties à relativiser leurs prétentions, si légitimes qu’elles puissent paraître de prime abord. Les procédures trop correctes effacent cette réalité première et entraînent souvent le gel des positions et des dynamiques. Il faut saluer tout bon accord comme une étonnante et infiniment rare victoire collective de l’intelligence transcendant là les subjectivités généralement farouches.
Mais toute institution ou entreprise se fonde d’une vocation politico-économique définie dans ses racines technocratiques et son projet pré-totalitaire. Le pouvoir et ses gains, que chacun suppose lui revenir à terme, prennent le pas sur le sens toujours complexe de l’intérêt collectif qui est seulement sensible aux minorités éclairées à la vision prémonitoire de la complexité des organisations humaines échappant toujours aux meilleures sciences organisationnelles. Cette vision, non opérationnelle et sans souci comptable, ne touche que les individus prédisposés aux compromis et pouvant même céder sur leurs avantages personnels, leurs convictions ou leurs croyances. Cette intelligence subodorant les vices cachés dans toute entreprise humaine est toujours minoritaire et s’inscrit rarement dans la dynamique organisationnelle.
L’apparent prévaut. Valoir davantage de dollars où être mieux reconnu par ses titres, sa position ou son expérience crée une hiérarchie de référence. Cela rallie souvent l’avis prépondérant par démocratie du nombre plus que du principe. L’oiseau suit ainsi le meilleur chant et les moutons suivent celui que Panurge préféra pour le jeter à l’eau. Le groupe, fédéré par la clameur entourant qui s’affirme et uni par la rumeur autour du différent inacceptable devient un collectif politique à l’ostracisme latent et au discours venant faire foi jusqu’à la caricature.
Rien de symbolique venu d’ailleurs ne vient alors soutenir le sujet isolé de la meute et exclu de l’aventure toujours quelque peu prédatrice. C’est ici qu’apparait l’angoisse. Pour qui vaut peu sur le marché de l’humain employable, appartient faiblement et dispose de peu d’image, la surenchère matérialiste d’aujourd’hui renvoie à l’exclusion de façon pressante et poignante.
La liberté ? Chacun peut en mesurer l’usage immédiat, réaliste et possible dans sa famille, son entourage et ses entreprises…Il s’agit d’un constat d’impossibilité parfaitement instructif autant que douloureux, évalué dans la proximité. Il faut ici craindre les révélations de la lucidité transgressive qui cesse de croire et de s’affilier, voire de s’inféoder aveuglément.
La liberté ? Elle serait plutôt à rechercher dans ces rares moments d’équilibre hors de tout enjeu avec son environnement dans toutes ses composantes émotionnelles, matérielles, historiques et conjoncturelles. Savourer cela teint du miraculeux et n’autorise en rien à en faire un concept que l’on voudrait d’usage courant dans nos activités.
La liberté ? Peut-être est-elle toujours confisquée par une dominance idéologique, avouée ou non, incarnée ou non, présente ou mythique. Cette dominance n’a plus pour accessoires le muscle, la massue ou l’arc. Elle n’est plus du ressort du discours conjugué du pouvoir spirituel et politique. Elle ne se soutient même plus de la parole juste. La dominance d’aujourd’hui est opérationnelle. Elle se fonde des titres, des fonctions, des patrimoines, des prestiges transmis et des postures opportunes. Elle s’entretient des proclamations et des artifices méthodologiques, technologiques et médiatiques que portent nos nouveaux savoirs et les images « impactantes » médiatisées qui en émanent jusqu’à saturation.
Les nouvelles dominances sont comédiennes et jouent de la communication et du spectacle. Elles n’ont aucun besoin d’authenticité. Manipulatrices et sachant s’informer, elles peuvent se permettre d’être moins cruelles que les pouvoirs de jadis. Mais leur capacité de destruction s’accroît peut-être d’être devenue plus subtile…L’espace intime du sujet, jadis quelque peu préservé, est aujourd’hui violé sans cesse. Cet aspect du monde post moderne est infiniment peu étudié. L’idéologie à thèses se répand sur le mal-être et prétend en toute duplicité au bien-être par liberté ou consentement là où l’économie ne demande que des objets tentateurs et la bonne circulation des galères marchandes. Même l’incohérence, la revendication et le désespoir se manipulent.
Mais toute institution ou entreprise se fonde d’une vocation politico-économique définie dans ses racines technocratiques et son projet pré-totalitaire. Le pouvoir et ses gains, que chacun suppose lui revenir à terme, prennent le pas sur le sens toujours complexe de l’intérêt collectif qui est seulement sensible aux minorités éclairées à la vision prémonitoire de la complexité des organisations humaines échappant toujours aux meilleures sciences organisationnelles. Cette vision, non opérationnelle et sans souci comptable, ne touche que les individus prédisposés aux compromis et pouvant même céder sur leurs avantages personnels, leurs convictions ou leurs croyances. Cette intelligence subodorant les vices cachés dans toute entreprise humaine est toujours minoritaire et s’inscrit rarement dans la dynamique organisationnelle.
L’apparent prévaut. Valoir davantage de dollars où être mieux reconnu par ses titres, sa position ou son expérience crée une hiérarchie de référence. Cela rallie souvent l’avis prépondérant par démocratie du nombre plus que du principe. L’oiseau suit ainsi le meilleur chant et les moutons suivent celui que Panurge préféra pour le jeter à l’eau. Le groupe, fédéré par la clameur entourant qui s’affirme et uni par la rumeur autour du différent inacceptable devient un collectif politique à l’ostracisme latent et au discours venant faire foi jusqu’à la caricature.
Rien de symbolique venu d’ailleurs ne vient alors soutenir le sujet isolé de la meute et exclu de l’aventure toujours quelque peu prédatrice. C’est ici qu’apparait l’angoisse. Pour qui vaut peu sur le marché de l’humain employable, appartient faiblement et dispose de peu d’image, la surenchère matérialiste d’aujourd’hui renvoie à l’exclusion de façon pressante et poignante.
La liberté ? Chacun peut en mesurer l’usage immédiat, réaliste et possible dans sa famille, son entourage et ses entreprises…Il s’agit d’un constat d’impossibilité parfaitement instructif autant que douloureux, évalué dans la proximité. Il faut ici craindre les révélations de la lucidité transgressive qui cesse de croire et de s’affilier, voire de s’inféoder aveuglément.
La liberté ? Elle serait plutôt à rechercher dans ces rares moments d’équilibre hors de tout enjeu avec son environnement dans toutes ses composantes émotionnelles, matérielles, historiques et conjoncturelles. Savourer cela teint du miraculeux et n’autorise en rien à en faire un concept que l’on voudrait d’usage courant dans nos activités.
La liberté ? Peut-être est-elle toujours confisquée par une dominance idéologique, avouée ou non, incarnée ou non, présente ou mythique. Cette dominance n’a plus pour accessoires le muscle, la massue ou l’arc. Elle n’est plus du ressort du discours conjugué du pouvoir spirituel et politique. Elle ne se soutient même plus de la parole juste. La dominance d’aujourd’hui est opérationnelle. Elle se fonde des titres, des fonctions, des patrimoines, des prestiges transmis et des postures opportunes. Elle s’entretient des proclamations et des artifices méthodologiques, technologiques et médiatiques que portent nos nouveaux savoirs et les images « impactantes » médiatisées qui en émanent jusqu’à saturation.
Les nouvelles dominances sont comédiennes et jouent de la communication et du spectacle. Elles n’ont aucun besoin d’authenticité. Manipulatrices et sachant s’informer, elles peuvent se permettre d’être moins cruelles que les pouvoirs de jadis. Mais leur capacité de destruction s’accroît peut-être d’être devenue plus subtile…L’espace intime du sujet, jadis quelque peu préservé, est aujourd’hui violé sans cesse. Cet aspect du monde post moderne est infiniment peu étudié. L’idéologie à thèses se répand sur le mal-être et prétend en toute duplicité au bien-être par liberté ou consentement là où l’économie ne demande que des objets tentateurs et la bonne circulation des galères marchandes. Même l’incohérence, la revendication et le désespoir se manipulent.
La liberté a fort peu de place dans les organisations dont le projet s’est articulé dans un politique représenté par ce qui le signifie jusqu’à la caricature par les raccourcis et cette médiocrité discursive toujours majoritaire qui n’effraie personne. Le meneur d’hommes qui apparait comme libre, ne se ne révèle aujourd’hui que dans les naufrages d’économies, de société et même de civilisation où les têtes doctorales perdent leur latin et les têtes élues leur indice de popularité. Mais les régulations qu’il apporte sont plus souvent brutales que pacifiques. Les grenouilles de La Fontaine, insatisfaites du soliveau se donnèrent pour roi un croquemitaine… Il fallut qu’un Gandhi ou qu’un Mandela sortent de leurs prisons pour suggérer un autre possible. Mais on assassinat Jaurès, Luther King, Sadate et tant d’autres…
Qui rêve d’entreprise libérée devrait d’abord se donner les moyens d’y prendre le pouvoir. Il pourrait alors toucher son rêve du doigt. A cette place on découvre à quels excès « liberticides » l’exercice du pouvoir peut conduire les meilleures intentions. Le responsable sensé d’entreprise, d’institution ou de collectivité s’appliquera certes à éviter tout excès autoritariste. Mais bien vite il lui faudra restaurer les nécessités de la « corvée » pour assurer les tâches dévolues au collectif. Il lui faudra trouver les biais souvent truqueurs pour se parer de l’image de la « réussite ». A l’opposé, la confiance excessive engendrera maintes dérives. Dans tous les cas, l’usage des sanctions et récompenses brisera le souci égalitariste. L’habileté à l’exercice informulable de la gestion de l’humain ordinaire, indiscipliné, indocile et paresseux, fera alors à terme le manager compétent, et quelquefois même rusé, qui traverse les tempêtes organisationnelles et évite les sables mouvants de l’efficacité savante. La compétence ignore la multitude de détails imprévisibles où l’on s’enlise dès que l’on croire que l’on sait…
Rien n’est pire que les libérateurs idéologues confrontés à l’exercice effectif du pouvoir. Il faut ici entendre encore l’écho du cri d’Olympe de Gouges du haut de la charrette qui la menait, de droit révolutionnaire, à la guillotine : « Liberté que de crimes on commet en ton nom ! ». Ces crimes ne sont pas plus innocents que ceux commis au nom du profit personnel dont la violence avance bien moins masquée. Le cynisme du chiffre et de la démesure des cumuls campe les Ali baba d’aujourd’hui, fiers d’un étalage public qui n’a plus besoin de caverne. La rumeur médiatique glorifie la fortune sans vergogne. Cette liberté-là traduit la folie dérégulée actuelle de la possibilité non seulement d’entreprendre, mais surtout de celle de spéculer sur tout ce qui est devenu produit marchand. Mais l’électoralisme social qui semble s’y opposer n’est pas exempt de relents pervers. Un cynique disait : « L’élu populaire sera davantage porté à rechercher des avantages personnels que l’élu bourgeois qui est déjà riche ».
Le renoncement au profit personnel et aux médiocrités purement gestionnaires est-il le fait exclusif de l’un de ces marginaux portés là par l’écume du pire sur le drame de leur aventure ? Certes la philosophie grandit davantage par les torgnoles de la réalité reçues dans la solitude que par les leçons de l’université. La plupart d’entre les rescapés des désastres personnels ne se savent pas anarchistes, pas plus que Montesquieu, Voltaire ou Diderot. Gandhi et Mandela, qui ne revendiquaient en fait que leur liberté de pensée. On entendit dernièrement Nicolas Hulot dénoncer le sectarisme obtus et quelque peu pervers des courants écologistes divergents d’aujourd’hui où il croyait trouver sa juste place. Freud se pencha sur la violence inconsciente du symptôme humain qui fait chacun prisonnier de ses passions bien plus que soumis à Dieu ou Maître. Bien avant Lacan, Socrate, au prix d’une certaine sévérité pédagogique, démontra irréfutablement que l’exactitude de l’énoncé est en chacun d’entre nous.
Qui rêve d’entreprise libérée devrait d’abord se donner les moyens d’y prendre le pouvoir. Il pourrait alors toucher son rêve du doigt. A cette place on découvre à quels excès « liberticides » l’exercice du pouvoir peut conduire les meilleures intentions. Le responsable sensé d’entreprise, d’institution ou de collectivité s’appliquera certes à éviter tout excès autoritariste. Mais bien vite il lui faudra restaurer les nécessités de la « corvée » pour assurer les tâches dévolues au collectif. Il lui faudra trouver les biais souvent truqueurs pour se parer de l’image de la « réussite ». A l’opposé, la confiance excessive engendrera maintes dérives. Dans tous les cas, l’usage des sanctions et récompenses brisera le souci égalitariste. L’habileté à l’exercice informulable de la gestion de l’humain ordinaire, indiscipliné, indocile et paresseux, fera alors à terme le manager compétent, et quelquefois même rusé, qui traverse les tempêtes organisationnelles et évite les sables mouvants de l’efficacité savante. La compétence ignore la multitude de détails imprévisibles où l’on s’enlise dès que l’on croire que l’on sait…
Rien n’est pire que les libérateurs idéologues confrontés à l’exercice effectif du pouvoir. Il faut ici entendre encore l’écho du cri d’Olympe de Gouges du haut de la charrette qui la menait, de droit révolutionnaire, à la guillotine : « Liberté que de crimes on commet en ton nom ! ». Ces crimes ne sont pas plus innocents que ceux commis au nom du profit personnel dont la violence avance bien moins masquée. Le cynisme du chiffre et de la démesure des cumuls campe les Ali baba d’aujourd’hui, fiers d’un étalage public qui n’a plus besoin de caverne. La rumeur médiatique glorifie la fortune sans vergogne. Cette liberté-là traduit la folie dérégulée actuelle de la possibilité non seulement d’entreprendre, mais surtout de celle de spéculer sur tout ce qui est devenu produit marchand. Mais l’électoralisme social qui semble s’y opposer n’est pas exempt de relents pervers. Un cynique disait : « L’élu populaire sera davantage porté à rechercher des avantages personnels que l’élu bourgeois qui est déjà riche ».
Le renoncement au profit personnel et aux médiocrités purement gestionnaires est-il le fait exclusif de l’un de ces marginaux portés là par l’écume du pire sur le drame de leur aventure ? Certes la philosophie grandit davantage par les torgnoles de la réalité reçues dans la solitude que par les leçons de l’université. La plupart d’entre les rescapés des désastres personnels ne se savent pas anarchistes, pas plus que Montesquieu, Voltaire ou Diderot. Gandhi et Mandela, qui ne revendiquaient en fait que leur liberté de pensée. On entendit dernièrement Nicolas Hulot dénoncer le sectarisme obtus et quelque peu pervers des courants écologistes divergents d’aujourd’hui où il croyait trouver sa juste place. Freud se pencha sur la violence inconsciente du symptôme humain qui fait chacun prisonnier de ses passions bien plus que soumis à Dieu ou Maître. Bien avant Lacan, Socrate, au prix d’une certaine sévérité pédagogique, démontra irréfutablement que l’exactitude de l’énoncé est en chacun d’entre nous.
Nous voici parvenus au point où il faut quitter ce propos pour une séparation critique et constructive. J’entends la multitude des réfutations savantes riches de références et de postulats. Mais il faut ici inventer une nouvelle légèreté plus porteuse. Il fut démontré en école, il y a seulement un peu plus d’un siècle, que le poids de l’avion, dont on s’acharnait à produire le décollage, serait insupportable à l’air. L’infiniment petit nous tue par les micro-organismes, mais nous promet une énergie renouvelable maîtrisée et infinie. Saurons-nous inventer les cadres susceptibles de contenir les nouveaux savoirs et les nouveaux moyens ? Entreprise libérée ? Mais pour qui ? Et sous quelle forme ? Quel nouveau sens donner au travail ? Il protège déjà la majorité d’entre nous des déboires quotidiens du domestique, souvent plus douloureux que les besognes fastidieuses.
L’économie n’est qu’un macro effet différé et devenu démesuré des exigences du psychisme humain. L’argent fait souci partout comme on le découvrit au néolithique. Le fabuliste La Fontaine nous conta l’histoire du financier et du savetier. Cependant le fond de l’affaire humaine est ailleurs ; le manque constitutif qui caractérise l’humain exige des objets-écrans. Le cumul de monnaie est le plus efficace. On peut alors s’appuyer sur ce qui se compte faute d’avoir ce qui compte.
Il faut appeler là le témoignage psychanalytique sur le latent et le secret du manque fondamental de l’humain, dépossédé par sa mortalité, qui réside en chacun d’entre nous. Nous voici en ce point où le féminin, devenu émergent et fécond, se confronte et s’insurge publiquement face à ses impossibilités structurelles et aux vieux dénis sociaux. C’est ce que Freud ne sut vraiment résoudre. Le masculin ne saurait suffisamment répondre à un tel manque. Il surenchérit ailleurs dans une folie parallèle poussant aux probations compulsives de sa capacité de comblement. Certes il devient légal d’aller manifestement au semblable. Cet évitement rend probablement plus aimable et festive la pratique de la sexualité.
Entreprendre fait contournement, mais on revient toujours là où il faut se confronter à la perte primordiale, existentielle et émotionnelle de sens amoureux. Elle advient lorsque surgit au travers des réussites le sentiment de l’irréductible différence qui nous sépare de l’autre. Qui saurait se satisfaire alors du handicap des incomplétudes et des insuffisances du corps ? Un certain roi aurait donné son royaume pour un cheval.
La prédation économique effrénée et les cumuls financiers des seigneurs de l’économie ne rendent que plus amer l’irréductible des limites temporelles, émotionnelles et physiques de l’humain pour le commun. Se résoudre à un espace de vie que l’on sait réduit et finalement mortifère est une tâche ardue. Mais quelle grenouille ne veut se donner un meilleur volume ? Le goût pulsionnel et follement inflationniste de la liberté doit sans cesse se confronter à la nécessité des petites fidélités constructives de proximité qui demandent l’entretien d’une inconditionnalité suffisante.
C’est ici qu’il faut apprivoiser la complexité des relations en famille, en groupe et en entreprise. Brassens chantait « La mauvaise réputation ». Elle vient en corollaire de tout espérance libertaire. Tout nous fait village empli de jalousies, de hontes, de secrets et de colères. Chaque esprit se fait crypte de son histoire inaccomplie, toujours cruelle et parfois dramatique. La liberté pourrait s’entendre dans les creux du divan tolérant et discret que tend le psychanalyste averti sachant ses limites et le pouvoir de son silence. Mais les communautés humaines sont faites des semblants que chacun se donne. On peut parfois en dénoncer les abus…
Mais les droits et les règlements ne favorisent en rien une communication transgressive qui rendrait la liberté égalitaire, voire même fraternelle. On peut certes imaginer un jeu sans bluff ni tricherie où le désir oserait postuler la nécessité du soin à prendre de l’autre, mais saurait-on le rendre vivable ? Associer liberté et parole authentique parait légitime. Mais plus on triche, plus il faut dénier la faiblesse humaine de l’autre par cette perfection formelle de l’énoncé scolastique qui déclare tel Tartuffe : « Cachez ce sein que je ne saurais voir ! ». L’Université affiche le chiffre et dissimule l’inchiffrable de la chair.
Mais Eschyle et Socrate démontrèrent, il y a déjà longtemps, que le drame humain, fait d’ignorance, de violence, de solitude, de secret et parfois de haine, ne se résout que par une mise en scène paritaire (et locale) du dialogue. Il faut saisir là l’émergence signifiante de l’énonciation faisant impact théâtral où se partage une meilleure intelligence advenant sans dieu ni maître.
Mais elle est étouffée par : « ces cerveaux embués qui peuplent de plus en plus notre joli monde bien formaté par tant de discours tellement outrageusement convenus et complaisamment ânonnés, du prêt à penser… mou, vite et vide » ! comme nous le signifie Omar Aktouf.
Emmanuel Diet souligne en philosophe la destruction de l’intime par le « forçage techniciste » au service du « divin marché ». Le totalitarisme sournois de l’impérialisme économique génère ce qu’il décrit comme « une emprise par effraction de l’intime » avec un « psychologisme » devenant le poison subtil qui soumet les nouveaux esclaves. La psychanalyse elle-même glisse du libertaire, qui était sa vocation, vers l’usage pervers qui fait la fortune et la jouissance des maîtres… On pourrait définir cela comme : "Pratiques perverses de l'intelligentsia socio libérale post moderne. Dissimulation confiscatoire et discrète des nouveaux privilèges de caste par le socio-libéralisme "bobo/baba" s'entourant du cocon de la "pensée correcte" tissé par des médiocrités intellectuelles parfaitement efficaces, médiatisées et encouragées. Complicités objectives du grand capital, du politique institutionnel et du savoir universitaire aseptisé. Un discours simplifié uni formisateur hypocritement démagogue par la débilité sémantique et pauvreté argumentaire. Formalisme scientifique sélectif masqué d’une intentionnalité bienveillante d’annonce et de principe. Démocratie d’apparence devenu protectrice implicite de l’oligarchie dominante. »
L’économie n’est qu’un macro effet différé et devenu démesuré des exigences du psychisme humain. L’argent fait souci partout comme on le découvrit au néolithique. Le fabuliste La Fontaine nous conta l’histoire du financier et du savetier. Cependant le fond de l’affaire humaine est ailleurs ; le manque constitutif qui caractérise l’humain exige des objets-écrans. Le cumul de monnaie est le plus efficace. On peut alors s’appuyer sur ce qui se compte faute d’avoir ce qui compte.
Il faut appeler là le témoignage psychanalytique sur le latent et le secret du manque fondamental de l’humain, dépossédé par sa mortalité, qui réside en chacun d’entre nous. Nous voici en ce point où le féminin, devenu émergent et fécond, se confronte et s’insurge publiquement face à ses impossibilités structurelles et aux vieux dénis sociaux. C’est ce que Freud ne sut vraiment résoudre. Le masculin ne saurait suffisamment répondre à un tel manque. Il surenchérit ailleurs dans une folie parallèle poussant aux probations compulsives de sa capacité de comblement. Certes il devient légal d’aller manifestement au semblable. Cet évitement rend probablement plus aimable et festive la pratique de la sexualité.
Entreprendre fait contournement, mais on revient toujours là où il faut se confronter à la perte primordiale, existentielle et émotionnelle de sens amoureux. Elle advient lorsque surgit au travers des réussites le sentiment de l’irréductible différence qui nous sépare de l’autre. Qui saurait se satisfaire alors du handicap des incomplétudes et des insuffisances du corps ? Un certain roi aurait donné son royaume pour un cheval.
La prédation économique effrénée et les cumuls financiers des seigneurs de l’économie ne rendent que plus amer l’irréductible des limites temporelles, émotionnelles et physiques de l’humain pour le commun. Se résoudre à un espace de vie que l’on sait réduit et finalement mortifère est une tâche ardue. Mais quelle grenouille ne veut se donner un meilleur volume ? Le goût pulsionnel et follement inflationniste de la liberté doit sans cesse se confronter à la nécessité des petites fidélités constructives de proximité qui demandent l’entretien d’une inconditionnalité suffisante.
C’est ici qu’il faut apprivoiser la complexité des relations en famille, en groupe et en entreprise. Brassens chantait « La mauvaise réputation ». Elle vient en corollaire de tout espérance libertaire. Tout nous fait village empli de jalousies, de hontes, de secrets et de colères. Chaque esprit se fait crypte de son histoire inaccomplie, toujours cruelle et parfois dramatique. La liberté pourrait s’entendre dans les creux du divan tolérant et discret que tend le psychanalyste averti sachant ses limites et le pouvoir de son silence. Mais les communautés humaines sont faites des semblants que chacun se donne. On peut parfois en dénoncer les abus…
Mais les droits et les règlements ne favorisent en rien une communication transgressive qui rendrait la liberté égalitaire, voire même fraternelle. On peut certes imaginer un jeu sans bluff ni tricherie où le désir oserait postuler la nécessité du soin à prendre de l’autre, mais saurait-on le rendre vivable ? Associer liberté et parole authentique parait légitime. Mais plus on triche, plus il faut dénier la faiblesse humaine de l’autre par cette perfection formelle de l’énoncé scolastique qui déclare tel Tartuffe : « Cachez ce sein que je ne saurais voir ! ». L’Université affiche le chiffre et dissimule l’inchiffrable de la chair.
Mais Eschyle et Socrate démontrèrent, il y a déjà longtemps, que le drame humain, fait d’ignorance, de violence, de solitude, de secret et parfois de haine, ne se résout que par une mise en scène paritaire (et locale) du dialogue. Il faut saisir là l’émergence signifiante de l’énonciation faisant impact théâtral où se partage une meilleure intelligence advenant sans dieu ni maître.
Mais elle est étouffée par : « ces cerveaux embués qui peuplent de plus en plus notre joli monde bien formaté par tant de discours tellement outrageusement convenus et complaisamment ânonnés, du prêt à penser… mou, vite et vide » ! comme nous le signifie Omar Aktouf.
Emmanuel Diet souligne en philosophe la destruction de l’intime par le « forçage techniciste » au service du « divin marché ». Le totalitarisme sournois de l’impérialisme économique génère ce qu’il décrit comme « une emprise par effraction de l’intime » avec un « psychologisme » devenant le poison subtil qui soumet les nouveaux esclaves. La psychanalyse elle-même glisse du libertaire, qui était sa vocation, vers l’usage pervers qui fait la fortune et la jouissance des maîtres… On pourrait définir cela comme : "Pratiques perverses de l'intelligentsia socio libérale post moderne. Dissimulation confiscatoire et discrète des nouveaux privilèges de caste par le socio-libéralisme "bobo/baba" s'entourant du cocon de la "pensée correcte" tissé par des médiocrités intellectuelles parfaitement efficaces, médiatisées et encouragées. Complicités objectives du grand capital, du politique institutionnel et du savoir universitaire aseptisé. Un discours simplifié uni formisateur hypocritement démagogue par la débilité sémantique et pauvreté argumentaire. Formalisme scientifique sélectif masqué d’une intentionnalité bienveillante d’annonce et de principe. Démocratie d’apparence devenu protectrice implicite de l’oligarchie dominante. »
En guise de conclusion
Voici le sujet nouveau mis en ordre, voué à l’efficacité compétente, cadré et placé sous vigilance thérapeutique. On fait métier de ce ménage formatant et aseptiseur. Mais comment redécouvrir désir et plaisir sans désordre créateur ? Qui ose dire que l’entreprise libérée devrait sentir le large, le rêve et le partage hasardeux d’aventure ? Rêvons ici d’une organisation qui deviendrait équipage. Mais ici il faut citer Heredia : « Routiers et capitaines partaient ivres d’un rêve héroïque et brutal… ». N’oublions pas qu’Ulysse perdit tous ses compagnons.
Avec le recul je me surprends rétroactivement effrayé par tous ces moments de direction assumée où je fus seulement moi-même, tissé de faiblesses et d’approximations, faute de savoir ou de pouvoir être manager ou thérapeute. Les organisations que j’étais censé piloter s’en trouvèrent troublées, mais sans doute plus réactives. Avec certains voyous que je croise nous échangeons une lueur amusée dans le regard. Nous avons vécu ensemble. C’est une complicité inavouable. C’est la liberté qui ne se condense, ni ne s’énonce. Il est des instants où l’on saisit au passage comment Socrate put boire sereinement sa cigüe comme il eut pu en faire une simple libation. Nous avons justement la peine de mort en horreur. Mais la mort est-elle vraiment une peine lorsqu’elle prend sens ?
Avec le recul je me surprends rétroactivement effrayé par tous ces moments de direction assumée où je fus seulement moi-même, tissé de faiblesses et d’approximations, faute de savoir ou de pouvoir être manager ou thérapeute. Les organisations que j’étais censé piloter s’en trouvèrent troublées, mais sans doute plus réactives. Avec certains voyous que je croise nous échangeons une lueur amusée dans le regard. Nous avons vécu ensemble. C’est une complicité inavouable. C’est la liberté qui ne se condense, ni ne s’énonce. Il est des instants où l’on saisit au passage comment Socrate put boire sereinement sa cigüe comme il eut pu en faire une simple libation. Nous avons justement la peine de mort en horreur. Mais la mort est-elle vraiment une peine lorsqu’elle prend sens ?
Présentation de l'auteur
Georges Botet Pradeilles est Docteur en psychologie. Il a notamment travaillé avec Piaget sur une approche psychopathologique, opératoire et psychanalytique des processus cognitifs. Il est par ailleurs Directeur honoraire d’Etablissements spécialisés et Président honoraire de l’Institut Psychanalyse et Management.
Membre associé de l’Association Européenne Abraham-Torok (psychanalyse), il est membre cotisant de la société de philosophie des sciences de gestion et President de l'a Association My Coach (coaching solidaire)
Il est par ailleurs l'auteur de 7 ouvrages :
- Chez L'Harmattan
Sans Queue ni tête : Un monde actuel en perte de sens ? (2016)
Le Temps est au jeu de dupes : Ne pas s'y prendre et ne pas s'y faire prendre ! (2015)
Apologie de la névrose : Suivi de En écho de Marcienne Martin (2014)
- Chez Dédicaces
Fallait - il tuer Socrate ou l'assassinat collectif de la vertu ?
Nouveaux propos sur le bonheur
Pourquoi encore la psychanalyse
- Chez Edilivre :
Aphorisme à usage intime
Tél : 0678254824 botetg@club-internet.fr
Membre associé de l’Association Européenne Abraham-Torok (psychanalyse), il est membre cotisant de la société de philosophie des sciences de gestion et President de l'a Association My Coach (coaching solidaire)
Il est par ailleurs l'auteur de 7 ouvrages :
- Chez L'Harmattan
Sans Queue ni tête : Un monde actuel en perte de sens ? (2016)
Le Temps est au jeu de dupes : Ne pas s'y prendre et ne pas s'y faire prendre ! (2015)
Apologie de la névrose : Suivi de En écho de Marcienne Martin (2014)
- Chez Dédicaces
Fallait - il tuer Socrate ou l'assassinat collectif de la vertu ?
Nouveaux propos sur le bonheur
Pourquoi encore la psychanalyse
- Chez Edilivre :
Aphorisme à usage intime
Tél : 0678254824 botetg@club-internet.fr
Autres articles

 Accueil
Accueil Ligne éditoriale
Ligne éditoriale



 4.55 Pour libérer l'entreprise des chaînes aliénantes du pouvoir, le dirigeant ne doit - il pas commencer par se libérer lui même ? Par Georges Botet Pradeilles, Docteur en psychologie
4.55 Pour libérer l'entreprise des chaînes aliénantes du pouvoir, le dirigeant ne doit - il pas commencer par se libérer lui même ? Par Georges Botet Pradeilles, Docteur en psychologie



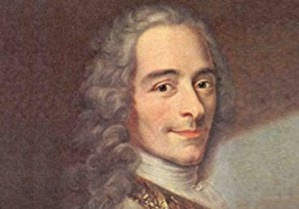








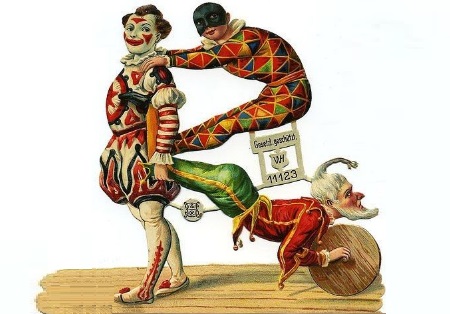


















 Accueil
Accueil