Introduction
Ces dernières années, les médias ont été largement investis par le discours d'une vague d’entrepreneurs vantant les mérites de " nouvelles " pratiques de management favorisant une culture de l'autonomie et de la prise d'initiatives. Ainsi ont vu le jour de nouveaux modèles de management plus participatifs et plus collaboratifs. Le phénomène des entreprises libérées participe de ce mouvement global ciblant la performance économique par l'innovation sociale.
A l’occasion de la conférence Boosting social entreprise in Europe en juillet dernier (2) qui lançait la présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne, les intervenants (3) ont bien rappelé que la gouvernance démocratique était un élément central de l’identité des entreprises sociales. Abondant dans ce sens, de nombreuses interventions du public ont souligné que les spécificités de l’économie sociale ne se résumaient pas à ses finalités sociales.
Toutefois, si les caractéristiques propres de ces entreprises ainsi que les défis spécifiques qu’elles rencontrent appellent des modèles de gouvernance adaptés, la seule auto-proclamation d’ " entreprise sociale " ou l’appartenance au secteur de l’économie sociale sont désormais insuffisants pour faire gage d’une gouvernance démocratique effective. Par ailleurs, les structures de l’économie sociale sont en perpétuelle interrogation sur les moyens de rendre leurs modes d’organisation et leurs modalités de prises de décision plus participatives.
La question peut donc être posée : l'économie sociale devrait-elle s'inspirer du mouvement de libération des entreprises pour accomplir ses missions et objectifs ?
Dans quelle mesure le modèle des entreprises libérées peut-il inspirer de nouvelles approches managériales au sein de l'économie sociale ? La libération des entreprises constitue-t-elle véritablement une réponse à la perte de sens du travail, à la démotivation, au désengagement et à la souffrance au travail ? Les changements de ce nouveau type de management mis en pratique dans le secteur privé lucratif et le public sont-ils pertinents dans le cadre d’une implantation dans l’économie sociale? À travers ces questionnements, nous interrogerons l'idéologie animant ce concept. Puis, en notant les spécificités du secteur de l'économie sociale, notamment en termes de gouvernance et d'objectifs sociétaux, nous nous demanderons s'il est pertinent de vouloir " libérer " les structures d'économie sociale.
A l’occasion de la conférence Boosting social entreprise in Europe en juillet dernier (2) qui lançait la présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne, les intervenants (3) ont bien rappelé que la gouvernance démocratique était un élément central de l’identité des entreprises sociales. Abondant dans ce sens, de nombreuses interventions du public ont souligné que les spécificités de l’économie sociale ne se résumaient pas à ses finalités sociales.
Toutefois, si les caractéristiques propres de ces entreprises ainsi que les défis spécifiques qu’elles rencontrent appellent des modèles de gouvernance adaptés, la seule auto-proclamation d’ " entreprise sociale " ou l’appartenance au secteur de l’économie sociale sont désormais insuffisants pour faire gage d’une gouvernance démocratique effective. Par ailleurs, les structures de l’économie sociale sont en perpétuelle interrogation sur les moyens de rendre leurs modes d’organisation et leurs modalités de prises de décision plus participatives.
La question peut donc être posée : l'économie sociale devrait-elle s'inspirer du mouvement de libération des entreprises pour accomplir ses missions et objectifs ?
Dans quelle mesure le modèle des entreprises libérées peut-il inspirer de nouvelles approches managériales au sein de l'économie sociale ? La libération des entreprises constitue-t-elle véritablement une réponse à la perte de sens du travail, à la démotivation, au désengagement et à la souffrance au travail ? Les changements de ce nouveau type de management mis en pratique dans le secteur privé lucratif et le public sont-ils pertinents dans le cadre d’une implantation dans l’économie sociale? À travers ces questionnements, nous interrogerons l'idéologie animant ce concept. Puis, en notant les spécificités du secteur de l'économie sociale, notamment en termes de gouvernance et d'objectifs sociétaux, nous nous demanderons s'il est pertinent de vouloir " libérer " les structures d'économie sociale.
1. L'entreprise libérée, vecteur de gouvernance élargie ou tour de passe-passe managérial
1.1 L'ancrage historique des entreprises libérées
Pour comprendre l'avènement d'une économie plus collaborative, il nous faut examiner les changements opérés dans les modes de travail et de salariat issus de la révolution industrielle. Nous sommes progressivement passés d'un mode de management hiérarchique datant du début du 19ème siècle - où les industries en pleine expansion avaient besoin de système d'organisation standardisé et d'une main d’oeuvre disciplinée pour répondre aux besoins de la consommation de masse, à une économie des services et à un management " orienté client ". La mutation économique opérée par le déclin de l'industrie et l'émergence du troisième secteur modifie profondément les approches. À l'heure du libéralisme triomphant, l'individu acquiert de nouvelles libertés et doit se créer un nouveau référentiel de normes : il ne doit plus obéir aux ordres, respecter la règle mais créer ses propres règles, se créer lui - même.
La configuration des attentes sociales face au travail a changé. Il s'agit aujourd'hui d'être entrepreneur de sa vie. Cela signifie un degré accru d'autonomie, une responsabilisation croissante, des possibilités de choix élargies, une liberté " augmentée ". L individu est pris dans une individualisation toujours croissante, où la satisfaction de ses besoins personnels (en tête desquels se place la réalisation de soi, le plus haut degré d’achèvement des besoins selon Maslow) prime sur le respect de règles extérieures ou l'inscription subordonnée à un collectif tel l'entreprise. Cette aspiration rompt radicalement avec la place et le rôle assigné au travailleur du 19ème siècle. Elle s'oppose aux lignes hiérarchiques imposées, à un modèle d'autorité perçu comme opprimant, à l'absence de sens dans les tâches effectuées, au sentiment d'être sous contrôle, sous contrainte, en bref aliéné.
La configuration des attentes sociales face au travail a changé. Il s'agit aujourd'hui d'être entrepreneur de sa vie. Cela signifie un degré accru d'autonomie, une responsabilisation croissante, des possibilités de choix élargies, une liberté " augmentée ". L individu est pris dans une individualisation toujours croissante, où la satisfaction de ses besoins personnels (en tête desquels se place la réalisation de soi, le plus haut degré d’achèvement des besoins selon Maslow) prime sur le respect de règles extérieures ou l'inscription subordonnée à un collectif tel l'entreprise. Cette aspiration rompt radicalement avec la place et le rôle assigné au travailleur du 19ème siècle. Elle s'oppose aux lignes hiérarchiques imposées, à un modèle d'autorité perçu comme opprimant, à l'absence de sens dans les tâches effectuées, au sentiment d'être sous contrôle, sous contrainte, en bref aliéné.
Une autre explication à l'urgence de penser de nouveaux modèles de management tant sur le plan stratégique qu organisationnel est la problématique de la souffrance au travail. " Les travaux épidémiologiques ou statistiques sur la santé mentale et physique au travail montrent que ce qui est délétère, c’est une pression forte combinée avec d’autres facteurs, comme le manque de possibilités de maîtriser son travail, le manque de ressources cognitives, le manque de possibilités d’évoluer, d’accroître ses compétences, de possibilités d’être créatif, de reconnaissance. Pour ceux qui en disposent, tout cela est extrêmement protecteur vis-à-vis des dégâts de la pression. (...) Les enquêtes le montrent : les possibilités de coopérer, d’échanger avec les autres sont jugées très importantes. Les personnes qui sont sous pression mais qui peuvent coopérer se sentent souvent mieux que celles qui ne sont pas sous pression mais qui sont isolées dans leur travail. " (4)
Nous verrons plus loin en quoi le modèle des entreprises libérées peut répondre ou non à cette problématique. Notons dès à présent la nécessité de maîtriser son travail, d évoluer, d’accroître ses compétences, d'être créatif, reconnu, ainsi que le besoin de coopérer, d'échanger pour supporter la pression au travail, et garantir la santé physique et mentale des travailleurs. Au niveau des entreprises également les attentes envers les travailleurs ont évolué, modifiant considérablement les profils recherchés au sein des équipes mais aussi au niveau des fonctions managériales.
Le concept d'entreprise libérée s'inspire de différents courants de pensée qui l'ont enrichi au fil du temps : des entreprises " dites utopiques " de Charles Fourier, de l'Ecole des Relations Humaines (Mayo, Mac Gregor), des travaux des psycho-sociologues sur la vie des groupes (Liberty, Lewin), de la doctrine sociale de l'Eglise, de la théorie personnaliste de Mounier, des théories managériales de la motivation des années 90, des expérimentations alternatives de Gérard Endenbourg (sociocratie) ou Brian Roberston (Holacratie) et enfin des pionniers comme Jean-François Zobrist, Michel Hervé, Stanislas Desjonquères et Alexandre Gérard.
Pour Jean-Claude Casalegno, on assiste aujourd'hui à un " précipité de l histoire " (5), c'est-à-dire à une rencontre entre des idées et des besoins sociaux qui font que ce concept est autorisé à exister.
Nous verrons plus loin en quoi le modèle des entreprises libérées peut répondre ou non à cette problématique. Notons dès à présent la nécessité de maîtriser son travail, d évoluer, d’accroître ses compétences, d'être créatif, reconnu, ainsi que le besoin de coopérer, d'échanger pour supporter la pression au travail, et garantir la santé physique et mentale des travailleurs. Au niveau des entreprises également les attentes envers les travailleurs ont évolué, modifiant considérablement les profils recherchés au sein des équipes mais aussi au niveau des fonctions managériales.
Le concept d'entreprise libérée s'inspire de différents courants de pensée qui l'ont enrichi au fil du temps : des entreprises " dites utopiques " de Charles Fourier, de l'Ecole des Relations Humaines (Mayo, Mac Gregor), des travaux des psycho-sociologues sur la vie des groupes (Liberty, Lewin), de la doctrine sociale de l'Eglise, de la théorie personnaliste de Mounier, des théories managériales de la motivation des années 90, des expérimentations alternatives de Gérard Endenbourg (sociocratie) ou Brian Roberston (Holacratie) et enfin des pionniers comme Jean-François Zobrist, Michel Hervé, Stanislas Desjonquères et Alexandre Gérard.
Pour Jean-Claude Casalegno, on assiste aujourd'hui à un " précipité de l histoire " (5), c'est-à-dire à une rencontre entre des idées et des besoins sociaux qui font que ce concept est autorisé à exister.
1.2 La création d'un nouveau leadership assurant l'innovation, l'agilité et l'engagement
Les conditions du succès de l'entreprise d'aujourd'hui reposeraient, d'après le professeur Maurice Thévenet de l'Essec, sur " la qualité du patron et du projet ". Pas d'engagement des salariés sans leader charismatique et vision transcendante (7). Laurence Vanhee, " Chief Happiness Officer " au Ministère belge de la Sécurité Sociale de 2009 à 2013 parle quant à elle d' " egoless leader " et érige sa mission en sacerdoce. " Le leadership, exercé avec passion et dans l’intérêt du plus grand nombre (et non pour son petit ego personnel) est une vraie source de valeur ajoutée dans l’entreprise. Etre un leader, c’est inspirer ses collègues, c’est aider à fluidifier les réalisations, c’est encourager dans les moments difficiles. On est leader parce qu’on aime enthousiasmer, on aime donner l’envie d’avoir envie " comme le dit si bien Olivier Lajous, Amiral de la Marine française. Le contrôle, quant à lui, peut être confié à chaque personne qui " va, au bénéfice de l’équipe, contrôler que les bons niveaux de quantité et de qualité sont atteints, avec les bonnes attitudes. "
Le rôle de contrôle est évacué de la fonction du manager. A présent, chaque individu est responsable devant le groupe et chaque membre du groupe a le pouvoir de contrôler son collègue. Le manager peut ainsi inspirer la confiance et non plus la crainte. On passe d'un modèle managérial de la motivation (donner l'envie) à celui de l'inspiration (donner l'envie d'avoir envie). D'un modèle du contrôle (norme externe) à un modèle de la responsabilisation (norme interne). On franchit là une étape supplémentaire vers l'intériorisation de la norme et de la performance, et donc vers l'invisibilisation du pouvoir.
Le même amiral Lajous nous dit, à l’occasion de l'université Hommes-Entreprise du 28 août dernier sur le Bonheur et la performance, que " le leader doit être au service de la mission qu'il a à remplir : être au service de son équipe. " Il doit être " un guide, avec humilité et amour (sic) ", à l'opposé d'un donneur d'ordre. Il doit permettre de " libérer les bonnes énergies ". On perçoit ici toute la dimension mystique qui entoure la figure charismatique du leader dont le rôle est d'inspirer, de fluidifier, d'encourager, d'être au service des autres, de libérer les bonnes énergies.
Ainsi Alexandre Gérard (Chrono flex) parle de l'électrochoc reçu suite à une conférence de Jean-François Zobrist, l'un des précurseurs des entreprises libérées : " J'ai compris que je gérais l'entreprise pour les 3% de salariés qui trichent et ne respectent pas les règles... Je réagissais par la contrainte, les notes de services ou la sanction, sans me rendre compte que je mettais le reste des salariés en prison, ce qui privait l'entreprise de son intelligence collective " (8).
On entre ici dans un récit de la rédemption et de l'appel reçu (Jean-François Zobrist parle d'un " rêve qui s'est révélé ") dont on perçoit bien ici la dimension mystique.
Les organisations, face aux défis d'une concurrence mondialisée, sont plongées dans un monde en constante mutation, accélérée par les évolutions numériques, l'horizontalisation des ressources (notamment des rapports humains), de l'information et des compétences. Elles doivent s'adapter en créant des solutions à la fois souples, rapides et inédites. Ces exigences se répercutent au niveau du recrutement et du maintien de l'emploi au sein des entreprises : elles sont en recherche de collaborateurs avec un fort pouvoir d'innovation, contraintes à plus de flexibilité mais également à plus d' " agilité ", à plus de " dynamisme " et très certainement à plus d'engagement de la part de leurs collaborateurs. Avec l'instauration d'un management plus collaboratif, elles font ainsi le pari que ce nouveau mode d'organisation des rapports entre collaborateurs (mais aussi de l'espace physique) leur permettra de relever ces nouveaux défis.
La posture du manager s'en trouve profondément modifiée. Le chef ne commande ni ne décide plus de manière quasi autocratique, il n'est plus non plus le responsable de ses équipes et de leur motivation, celles-ci s'autogèrent et co-décident. Si le leader reste une figure importante, le pouvoir du middle management tend à se diluer dans d autres fonctions, à s’exercer de manière collégiale, voire à disparaître. A titre d'exemple le groupe parapétrolier CGG, une structure des plus traditionnelles , vient de supprimer tout un étage de son organigramme pour gagner en " agilité " (6).
Les conditions du succès de l'entreprise d'aujourd'hui reposeraient, d'après le professeur Maurice Thévenet de l'Essec, sur " la qualité du patron et du projet ". Pas d'engagement des salariés sans leader charismatique et vision transcendante (7). Laurence Vanhee, " Chief Happiness Officer " au Ministère belge de la Sécurité Sociale de 2009 à 2013 parle quant à elle d' " egoless leader " et érige sa mission en sacerdoce. " Le leadership, exercé avec passion et dans l’intérêt du plus grand nombre (et non pour son petit ego personnel) est une vraie source de valeur ajoutée dans l’entreprise. Etre un leader, c’est inspirer ses collègues, c’est aider à fluidifier les réalisations, c’est encourager dans les moments difficiles. On est leader parce qu’on aime enthousiasmer, on aime donner l’envie d’avoir envie " comme le dit si bien Olivier Lajous, Amiral de la Marine française. Le contrôle, quant à lui, peut être confié à chaque personne qui " va, au bénéfice de l’équipe, contrôler que les bons niveaux de quantité et de qualité sont atteints, avec les bonnes attitudes. "
Le rôle de contrôle est évacué de la fonction du manager. A présent, chaque individu est responsable devant le groupe et chaque membre du groupe a le pouvoir de contrôler son collègue. Le manager peut ainsi inspirer la confiance et non plus la crainte. On passe d'un modèle managérial de la motivation (donner l'envie) à celui de l'inspiration (donner l'envie d'avoir envie). D'un modèle du contrôle (norme externe) à un modèle de la responsabilisation (norme interne). On franchit là une étape supplémentaire vers l'intériorisation de la norme et de la performance, et donc vers l'invisibilisation du pouvoir.
Le même amiral Lajous nous dit, à l’occasion de l'université Hommes-Entreprise du 28 août dernier sur le Bonheur et la performance, que " le leader doit être au service de la mission qu'il a à remplir : être au service de son équipe. " Il doit être " un guide, avec humilité et amour (sic) ", à l'opposé d'un donneur d'ordre. Il doit permettre de " libérer les bonnes énergies ". On perçoit ici toute la dimension mystique qui entoure la figure charismatique du leader dont le rôle est d'inspirer, de fluidifier, d'encourager, d'être au service des autres, de libérer les bonnes énergies.
Ainsi Alexandre Gérard (Chrono flex) parle de l'électrochoc reçu suite à une conférence de Jean-François Zobrist, l'un des précurseurs des entreprises libérées : " J'ai compris que je gérais l'entreprise pour les 3% de salariés qui trichent et ne respectent pas les règles... Je réagissais par la contrainte, les notes de services ou la sanction, sans me rendre compte que je mettais le reste des salariés en prison, ce qui privait l'entreprise de son intelligence collective " (8).
On entre ici dans un récit de la rédemption et de l'appel reçu (Jean-François Zobrist parle d'un " rêve qui s'est révélé ") dont on perçoit bien ici la dimension mystique.
1.3 Dessiner un espace de jeu
En réaménageant les locaux, les espaces de travail et de réunion, les tenants de l’entreprise libérée estiment qu’on transformerait l'organisation et la gouvernance de l'entreprise même. Le souhait ici est de voir le changement spacial opéré dans l'organisation agir comme un acte performatif : si on crée un espace ouvert, fluide et convivial pour les travailleurs, ces derniers vont ipso facto collaborer de manière ouverte fluide et conviviale.
L'attention portée au cadre de travail stimule l'efficacité des collaborateurs (9). Entre le travail à domicile, dans les espaces de co-working, les transports, chez les clients ou partenaires, la mobilité des équipes amène une réflexion sur l'occupation des espaces, selon leur usage et leur fréquentation. Chez Plantronics, spécialiste britannique de périphériques audio sans fils, près de la moitié des salariés du siège social ont fait le choix d'un bureau flexible, voire nomade, et travaillent, à leur convenance, dans les petits salons installés près de la cafétéria, dans des boxs, sur des canapés, ou sur des tables benchs (des grands plans de travail pouvant accueillir plusieurs postes). Un aménagement original qui a porté ses fruits : l'absentéisme a chuté et la productivité a grimpé de 20 %.
Le design des espaces de travail est un point central dans la stratégie de l'entreprise dans sa gestion des ressources humaines. En réaménageant les locaux, les espaces de travail ou de réunions, le manager transforme les espaces formels de travail en espaces informels tendant à confondre les différents cadres de vie. On efface les repères spatiaux tendant à délimiter les espaces mais également les temps de travail, on entretient une confusion entre espaces privé et professionnel. On floute les contours des espaces et des temps de repos, de loisir et de travail, jusqu'à les confondre. Tout ne serait plus qu'une immense pause-café (à l'instar des World Café) conviviale et récréative. Ce phénomène participe à ce que Vincent de Gaulejac appelle la ludification des conditions de travail (10).
L'attention portée au cadre de travail stimule l'efficacité des collaborateurs (9). Entre le travail à domicile, dans les espaces de co-working, les transports, chez les clients ou partenaires, la mobilité des équipes amène une réflexion sur l'occupation des espaces, selon leur usage et leur fréquentation. Chez Plantronics, spécialiste britannique de périphériques audio sans fils, près de la moitié des salariés du siège social ont fait le choix d'un bureau flexible, voire nomade, et travaillent, à leur convenance, dans les petits salons installés près de la cafétéria, dans des boxs, sur des canapés, ou sur des tables benchs (des grands plans de travail pouvant accueillir plusieurs postes). Un aménagement original qui a porté ses fruits : l'absentéisme a chuté et la productivité a grimpé de 20 %.
Le design des espaces de travail est un point central dans la stratégie de l'entreprise dans sa gestion des ressources humaines. En réaménageant les locaux, les espaces de travail ou de réunions, le manager transforme les espaces formels de travail en espaces informels tendant à confondre les différents cadres de vie. On efface les repères spatiaux tendant à délimiter les espaces mais également les temps de travail, on entretient une confusion entre espaces privé et professionnel. On floute les contours des espaces et des temps de repos, de loisir et de travail, jusqu'à les confondre. Tout ne serait plus qu'une immense pause-café (à l'instar des World Café) conviviale et récréative. Ce phénomène participe à ce que Vincent de Gaulejac appelle la ludification des conditions de travail (10).
2. Prescrire une greffe dans l'économie sociale
2.1 La réponse à une crise du pouvoir par le renforcement de la figure d'autorité...
En vérité, il est important de garder en tête que c’est en réponse à la crise du pouvoir dans l’entreprise " traditionnelle " et l'échec de son exercice dans ses formes strictement pyramidales et hiérarchisées que le concept d'entreprise libérée s'est déployé. Or il y a crise lorsque le pouvoir n'est ni efficace ni légitime.
Sur l'efficacité, Vincent Desportes, enseignant en stratégie à HEC et professeur associé à Sciences Po Paris, nous dit que la force principale d'une armée est sa discipline. Mais en même temps, si l'on n'arrive pas à créer des espaces d'initiatives qui vont permettre l'efficacité, rien ne fonctionne. Ainsi, " le chef militaire, comme le manager, est toujours dans cette recherche d'équilibre difficile entre l'esprit de discipline et l esprit d initiative ". (11)
Pour Laurent Ledoux, les principes de respect, de développement et d'autonomie, même s’ils ne sont pas poursuivis pour eux-mêmes mènent automatiquement de manière très forte à plus de créativité, plus d'innovation et donc représentent une condition de survie. L'équation de Frédéric Lippi, président du CA de l entreprise libérée Lippi, est simple : " la confiance associée à la bienveillance donne de la performance ". Celle de Jean-François Zobrist l'est tout autant : " C est l ouvrier heureux qui fait le client heureux. Et c est le client heureux qui fait l actionnaire heureux ". Lorsque Jean -François Zobrist nous parle des moyens pour y parvenir, il nous parle de ses trois principes : la bonté, l'amour du client et le partage d un rêve. Il nous enjoint à revenir à la fonction affective : Il faut arrêter de parler de chiffres. De toute façon, les chiffres sont faux. Dire aux gens " il faut que le client vous aime ", ça c est un objectif. La conséquence, c'est qu'on fait 20% de cash-flow. Dire " il faut faire 20% de cash-flow ", y a pas d objectif derrière. Pour lui, il faut " raisonner sur l affectif pour survivre ". a définition du management est limpide : il faut " ménager en manipulant " (12).
Selon Bourdieu, Pascal, Machiavel et d'autres, le jeu du pouvoir consiste à réussir à produire des effets de croyance. Les relations sociales sont toujours des relations de domination. La vie sociale, c'est le jeu où chacun veut dominer l'autre. Ce jeu structure toutes les relations.
Tout pouvoir doit s’atteler à conjurer le risque de la révolte, de la contestation, de la révolution, de la critique. Sa légitimité n'est jamais totale. Le pouvoir a besoin de l'autorité. L'autorité se caractérise par sa capacité à mobiliser (et non à contraindre comme dans le cas du pouvoir). C'est la capacité à faire qu'on y croit, sans pour autant nous faire croire, non pas parce que nous sommes dupés et trompés mais parce qu'on est entraîné dans une dynamique d'autorité (nous donner l'envie d'avoir envie). L'autorité est justement ce qui peut se passer des effets de théâtralisation ; sans avoir à jouer, à convaincre que c est vous le chef, que vous êtes légitime.
De ce fait, l'autorité exclut la coercition, sa puissance est telle qu'il n'a pas à la forcer. Mais si elle repose sur la reconnaissance qui vient d'en bas, cela n'implique pas ipso facto une relation égalitaire. Elle continue à instaurer des rapports hiérarchiques : en reconnaissant sa puissance et son efficacité, on exclut le débat, l'argumentation, la discussion. Elle ne se décrète pas mais elle ne se discute pas non plus.
On est donc toujours bien ici dans une recherche d'efficacité, de performance, de résultats au profit de l'entreprise (et de ses actionnaires le cas échéant) et non dans un engagement philanthropique dont la composante morale est purement et simplement instrumentalisée. Nous assistons là à une mystification, c'est-à-dire au passage de l'idée d'une tromperie collective d'ordres intellectuel et moral à une logique d’aliénation idéologique. (13)
Sur l'efficacité, Vincent Desportes, enseignant en stratégie à HEC et professeur associé à Sciences Po Paris, nous dit que la force principale d'une armée est sa discipline. Mais en même temps, si l'on n'arrive pas à créer des espaces d'initiatives qui vont permettre l'efficacité, rien ne fonctionne. Ainsi, " le chef militaire, comme le manager, est toujours dans cette recherche d'équilibre difficile entre l'esprit de discipline et l esprit d initiative ". (11)
Pour Laurent Ledoux, les principes de respect, de développement et d'autonomie, même s’ils ne sont pas poursuivis pour eux-mêmes mènent automatiquement de manière très forte à plus de créativité, plus d'innovation et donc représentent une condition de survie. L'équation de Frédéric Lippi, président du CA de l entreprise libérée Lippi, est simple : " la confiance associée à la bienveillance donne de la performance ". Celle de Jean-François Zobrist l'est tout autant : " C est l ouvrier heureux qui fait le client heureux. Et c est le client heureux qui fait l actionnaire heureux ". Lorsque Jean -François Zobrist nous parle des moyens pour y parvenir, il nous parle de ses trois principes : la bonté, l'amour du client et le partage d un rêve. Il nous enjoint à revenir à la fonction affective : Il faut arrêter de parler de chiffres. De toute façon, les chiffres sont faux. Dire aux gens " il faut que le client vous aime ", ça c est un objectif. La conséquence, c'est qu'on fait 20% de cash-flow. Dire " il faut faire 20% de cash-flow ", y a pas d objectif derrière. Pour lui, il faut " raisonner sur l affectif pour survivre ". a définition du management est limpide : il faut " ménager en manipulant " (12).
Selon Bourdieu, Pascal, Machiavel et d'autres, le jeu du pouvoir consiste à réussir à produire des effets de croyance. Les relations sociales sont toujours des relations de domination. La vie sociale, c'est le jeu où chacun veut dominer l'autre. Ce jeu structure toutes les relations.
Tout pouvoir doit s’atteler à conjurer le risque de la révolte, de la contestation, de la révolution, de la critique. Sa légitimité n'est jamais totale. Le pouvoir a besoin de l'autorité. L'autorité se caractérise par sa capacité à mobiliser (et non à contraindre comme dans le cas du pouvoir). C'est la capacité à faire qu'on y croit, sans pour autant nous faire croire, non pas parce que nous sommes dupés et trompés mais parce qu'on est entraîné dans une dynamique d'autorité (nous donner l'envie d'avoir envie). L'autorité est justement ce qui peut se passer des effets de théâtralisation ; sans avoir à jouer, à convaincre que c est vous le chef, que vous êtes légitime.
De ce fait, l'autorité exclut la coercition, sa puissance est telle qu'il n'a pas à la forcer. Mais si elle repose sur la reconnaissance qui vient d'en bas, cela n'implique pas ipso facto une relation égalitaire. Elle continue à instaurer des rapports hiérarchiques : en reconnaissant sa puissance et son efficacité, on exclut le débat, l'argumentation, la discussion. Elle ne se décrète pas mais elle ne se discute pas non plus.
On est donc toujours bien ici dans une recherche d'efficacité, de performance, de résultats au profit de l'entreprise (et de ses actionnaires le cas échéant) et non dans un engagement philanthropique dont la composante morale est purement et simplement instrumentalisée. Nous assistons là à une mystification, c'est-à-dire au passage de l'idée d'une tromperie collective d'ordres intellectuel et moral à une logique d’aliénation idéologique. (13)
2.2 ... Aux antipodes de l'économie sociale ?
Les entreprises d'économie sociale, comme toute entreprise, sont confrontées à des problèmes de gestion et de gouvernance interne. Sous le vocable " économie sociale " se regroupent un certain nombre de structures aux identités parfois bien contrastées : les ASBL, les fondations, les sociétés à finalité sociale (SFS), les coopératives et les mutuelles. Elles partagent toutefois un ensemble de caractéristiques communes dont une exigence de participation démocratique. Elles sont définies comme des structures plus " démocratiques " que celles du secteur dit " classique ". Cela s'inscrit dans les dispositifs statutaires et légaux que ces organisations doivent respecter, avec des spécificités selon la forme juridique adoptée. Cette dernière définit les conditions de participation des travailleurs aux organes de gestion.
Dans le cas des ASBL, l'assemblée générale regroupe les personnes physiques ou morales membres de l'association. Les travailleurs peuvent donc l'intégrer s'ils adhèrent à l'association, moyennant le paiement éventuel d'une cotisation. Il est également possible à partir de là de se faire élire au Conseil,d'Administration au même titre que les autres membres (sauf s'il existe différentes catégories de membres avec des pouvoirs particuliers, comme par exemple, les membres fondateurs, membres ordinaires).
Dans le cas des coopératives, leurs statuts ne prévoient pas d'obligation concernant la participation des travailleurs. Cependant, celles qui sont agréées par le Conseil National des Coopératives doivent intégrer dans leurs statuts des règles limitant le rôle prépondérant qu'un actionnaire pourrait jouer dans les décisions de l'assemblée générale (même si toutes les coopératives agréées ne sont pas fondées sur le principe absolu "un homme, une voix"). Ces bornes réglementaires font donc office de garde-fous et
donc de garants d’une certaine vision de l’économie et de la participation dans l’entreprise.
Dans les faits cependant, la participation des travailleurs aux organes de gestion est très faible. Près de la moitié des entreprises et des ASBL interrogées dans le cadre d'une enquête de l'Observatoire transfrontalier de l’économie sociale et solidaire ont au moins un travailleur dans leurs AG et CA mais celui-ci fait partie de la direction la plupart du temps. Aucune entreprise et seulement 4% des ASBL ont un travailleur hors direction dans leur CA. Et lorsque les travailleurs (direction ou non) sont présents soit au CA , soit à l’ AG , ils sont la plupart du temps peu nombreux.
Marthe Nyssen souligne à cet égard qu’il serait " illusoire de croire que la participation des travailleurs aux organes de décision permet, dans tous les cas, une réelle prise en compte de leurs opinions ", ajoutant que " cela dépend de différents facteurs, et notamment du statut du vote dans les prises de décision " (14). En effet, dans certaines ASBL, le pouvoir du conseil d’administration ou de la direction est tel que l’assemblée générale ne ressemble qu’à une " formalité où très peu de membres interviennent " (15).
Arianne Dewandre enfonce le clou en soulignant que " si la démocratie de gestion est une valeur fondamentale du secteur, et que beaucoup s’accordent sur l’importance de la participation des travailleurs, ces pratiques restent relativement peu développées dans l’économie sociale ". Force est de constater en effet que les entreprises tendent à omettre des mécanisme de participation à la décision à destination des travailleurs. Arianne Dewandre va même plus loin en s’interrogeant : " quand bien même des dispositifs existent, dans quelle mesure permettent -ils une participation réelle et démocratique ? "
Ainsi, si les valeurs fondatrices de l’économie sociale relativisent l’importance de la performance économique en remettant en question la structure pyramidale de l’entreprise traditionnelle héritée de la révolution industrielle, une observation de la réalité laisse transparaître une distanciation avec les principes que les structures de l’économie sociale ont elles-mêmes arrêtés. Marthe Nyssens rappelle que " quel que soit le pouvoir accordé au vote de chaque associé et donc à celui des travailleurs qui participent aux organes de décision, des difficultés naissent des rapports de pouvoir, d’inégalité de capital culturel, d’accessibilité et d’intelligibilité de l’information, et des ressources temporelles de chacun ", prenant à témoin les difficultés rencontrées à toute époque par les expériences de démocratie directe.
Dans le cas des ASBL, l'assemblée générale regroupe les personnes physiques ou morales membres de l'association. Les travailleurs peuvent donc l'intégrer s'ils adhèrent à l'association, moyennant le paiement éventuel d'une cotisation. Il est également possible à partir de là de se faire élire au Conseil,d'Administration au même titre que les autres membres (sauf s'il existe différentes catégories de membres avec des pouvoirs particuliers, comme par exemple, les membres fondateurs, membres ordinaires).
Dans le cas des coopératives, leurs statuts ne prévoient pas d'obligation concernant la participation des travailleurs. Cependant, celles qui sont agréées par le Conseil National des Coopératives doivent intégrer dans leurs statuts des règles limitant le rôle prépondérant qu'un actionnaire pourrait jouer dans les décisions de l'assemblée générale (même si toutes les coopératives agréées ne sont pas fondées sur le principe absolu "un homme, une voix"). Ces bornes réglementaires font donc office de garde-fous et
donc de garants d’une certaine vision de l’économie et de la participation dans l’entreprise.
Dans les faits cependant, la participation des travailleurs aux organes de gestion est très faible. Près de la moitié des entreprises et des ASBL interrogées dans le cadre d'une enquête de l'Observatoire transfrontalier de l’économie sociale et solidaire ont au moins un travailleur dans leurs AG et CA mais celui-ci fait partie de la direction la plupart du temps. Aucune entreprise et seulement 4% des ASBL ont un travailleur hors direction dans leur CA. Et lorsque les travailleurs (direction ou non) sont présents soit au CA , soit à l’ AG , ils sont la plupart du temps peu nombreux.
Marthe Nyssen souligne à cet égard qu’il serait " illusoire de croire que la participation des travailleurs aux organes de décision permet, dans tous les cas, une réelle prise en compte de leurs opinions ", ajoutant que " cela dépend de différents facteurs, et notamment du statut du vote dans les prises de décision " (14). En effet, dans certaines ASBL, le pouvoir du conseil d’administration ou de la direction est tel que l’assemblée générale ne ressemble qu’à une " formalité où très peu de membres interviennent " (15).
Arianne Dewandre enfonce le clou en soulignant que " si la démocratie de gestion est une valeur fondamentale du secteur, et que beaucoup s’accordent sur l’importance de la participation des travailleurs, ces pratiques restent relativement peu développées dans l’économie sociale ". Force est de constater en effet que les entreprises tendent à omettre des mécanisme de participation à la décision à destination des travailleurs. Arianne Dewandre va même plus loin en s’interrogeant : " quand bien même des dispositifs existent, dans quelle mesure permettent -ils une participation réelle et démocratique ? "
Ainsi, si les valeurs fondatrices de l’économie sociale relativisent l’importance de la performance économique en remettant en question la structure pyramidale de l’entreprise traditionnelle héritée de la révolution industrielle, une observation de la réalité laisse transparaître une distanciation avec les principes que les structures de l’économie sociale ont elles-mêmes arrêtés. Marthe Nyssens rappelle que " quel que soit le pouvoir accordé au vote de chaque associé et donc à celui des travailleurs qui participent aux organes de décision, des difficultés naissent des rapports de pouvoir, d’inégalité de capital culturel, d’accessibilité et d’intelligibilité de l’information, et des ressources temporelles de chacun ", prenant à témoin les difficultés rencontrées à toute époque par les expériences de démocratie directe.
Conclusion
Si l'on veut réellement parler de gouvernance participative dans les entreprises (d'économie sociale ou non), cela implique de questionner la portée de la relation asymétrique employeur -travailleur qui reste définie légalement comme une relation de subordination. En effet, comme le fait remarquer Ingrid Leruth, le souci des entreprises d'économie sociale est plus " centré sur la pérennité d’un projet social solide et des valeurs de production que sur la pratique d’un fonctionnement démocratique " (16).
Comment concevoir la participation dans ce cadre ambigu ? Il appartient bien aux managers de créer les conditions de la participation : en reconnaissant la parole des travailleurs sans qu'ils doivent craindre pour leur emploi, en les aidant dans la compréhension du contexte et des enjeux de leur structure, dans le développement de leur capacité d'écoute, d'analyse, d'argumentation, de négociation, et d'action. Il s'agit d'un véritable programme d' " empowerment " dans la droite ligne de l'Education Populaire, à l opposé de ce qu’ Anni orzeix, Julien Charles et Bénédicte Zimmermann appel lent " la participation discursive ".
C est ce programme que réalise l autogestion : " un modèle de gestion de l’entreprise, mais également un modèle de gestion de la société " (17). Avec l'engouement pour le modèle des entreprises libérées, l'autogestion se voit remettre au goût du jour et susciter à nouveau un intérêt, loin des anciens clichés post-soixante-huitards. En Belgique, loin d'être un effet de mode, la gouvernance en autogestion est pratiquée dans les associations de santé intégrée (plus connues sous le nom de " maisons médicales ") depuis des décennies maintenant. L'autonomie est, par essence, au coeur de leurs pratiques gestionnaires.
Ce qui ressort de la littérature est la qualification de l ’autogestion en tant qu’utopie. Selon Paul Ricoeur, " Utopie " signifie " nulle part ". Elle désigne quelque chose qui n’existe en aucun réel, et ouvre par là le champ de tous les possibles. Elle se caractérise par un aspect réactionnel à l’ordre dominant : elle est offensive. Elle vise au développement de perspectives nouvelles et alternatives. L’utopie est donc une pensée active qui s’affronte au problème du pouvoir et influence l’ordre social.
En mobilisant la notion d'autonomie, les entreprises libérées et les modèles autogestionnaires se réfèrent à la représentation que chacun peut se faire d'une vie " bonne ". En effet, à l'heure actuelle, qui peut ne pas vouloir " être soi ", " vivre sa propre vie ", " ne pas faire ce qu'on attend de nous mais ce que l'on désire vraiment " ? On l'a vu, dans la sphère du travail, " être autonome ", " prendre des initiatives ", " être porteur de projets ", " prendre part à la gestion des problèmes qui nous concernent " sont des comportements hautement valorisés et récompensés.
Ces termes aujourd'hui objets de méfiance à cause de la charge idéologique qu’ils véhiculent, ont cependant longuement été considérés comme porteurs d’un projet libérateur. C’est par exemple le cas de ce que Boltanski et Chiapello appellent, dans Le nouvel esprit du capitalisme, la " critique artiste " qui combattait le premier capitalisme et son mode d’organisation tayloriste au nom de la réalisation de soi, du respect de l’implication de chacun dans sa tâche et du droit à s’organiser soi -même avec davantage d’autonomie. Ce discours " libérateur ", pensent notamment ces deux auteurs, fut vite repris et endossé par des logiques systémiques exigences de flexibilité, de mobilité, d’inventivité…) caractéristiques de ce nouvel esprit capitaliste pour occuper la place qu’il occupe actuellement. Objet d’une perplexité inquiète, l’autonomie semble ne plus répondre au projet libérateur dont on l’avait investie " (18). Mais n'est-ce pas là le propre de l utopie ? Elle est dotée d’un caractère éphémère : elle émerge comme force d’opposition à l’ordre établi dans l’objectif d’impulser des transformations.
Nous pouvons penser que la pensée utopique suit l'évolution des mouvements sociaux qui l'ont fait naître. La dominante " militante " tend à s'effacer au profit d'une logique plus gestionnaire. Ou pour reprendre les termes de R. Lorent, on assiste au passage d'une logique " instituante " à une logique " organisationnelle " : " la dimension instituante est celle qui insuffle une nouvelle logique au coeur de la société, tandis que la dimension organisationnelle est celle qui assure au mouvement ses assises mobilisatrices d’abord, son rayonnement ensuite, sa pérennité assortie de divers ajustements imprévisibles dans la période pionnière, enfin " (19).
Gageons tout de même que la finalité sociale des entreprises sociales reste un élément central de leur démarche, au coeur de leur programme en tant qu'acteurs sociétaux majeurs. Pour que s'inscrive dans leur programme l'émancipation des personnes, en ce compris leurs travailleurs. Pour que soient gérées les entreprises selon des valeurs et des règles humanistes. Pour que se reflète dans les modes d'organisation démocratiques et participatifs des entreprises la construction d'une économie réellement sociale et d'un monde plus solidaire. Car la fin est aussi dans les moyens.
Bibliographie
Ouvrages :
Burawoy M., Produire le consentement, La Ville Brûle " Mouvement réel ", 2015.
Chatelin C., " La gouvernance est à l'organisation ce que l'atome est à la matière. Vers de nouveaux paradigmes pour la recherche en gouvernance " in Finet A., Gouvernance d entreprise, De Boeck Supérieur " Méthodes & Recherches ", 2009.
Deneault A. Gouvernance. Le management totalitaire, 2013.
Defourny J., Simon M., Adams S., Les coopératives en Belgique : Un mouvement d'avenir ?, Luc Pire.
Erhenberg A., La fatigue d'être soi, Paris, Odile Jacob, 2000.
Frydman B., " Habermas et la société civile contemporaine ", in La société civile et ses droits, Bruylant (col. Penser le droit), 2004.
De Gaulejac V., La société malade de la gestion, Paris, Seuil, 2005.
Mertens S., (sous la direction de), La gestion des entreprises sociales, Liège, Edipro, 2010.
Rey A. (sous la direction de), Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Le Robert, 2012.
Weber M., Le Savant et le Politique, 10/18, 2002.
Articles :
Burawoy M., Produire le consentement, La Ville Brûle " Mouvement réel ", 2015.
Chatelin C., " La gouvernance est à l'organisation ce que l'atome est à la matière. Vers de nouveaux paradigmes pour la recherche en gouvernance " in Finet A., Gouvernance d entreprise, De Boeck Supérieur " Méthodes & Recherches ", 2009.
Deneault A. Gouvernance. Le management totalitaire, 2013.
Defourny J., Simon M., Adams S., Les coopératives en Belgique : Un mouvement d'avenir ?, Luc Pire.
Erhenberg A., La fatigue d'être soi, Paris, Odile Jacob, 2000.
Frydman B., " Habermas et la société civile contemporaine ", in La société civile et ses droits, Bruylant (col. Penser le droit), 2004.
De Gaulejac V., La société malade de la gestion, Paris, Seuil, 2005.
Mertens S., (sous la direction de), La gestion des entreprises sociales, Liège, Edipro, 2010.
Rey A. (sous la direction de), Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Le Robert, 2012.
Weber M., Le Savant et le Politique, 10/18, 2002.
Articles :
Lorent R., Union nationale des mutualités socialistes, cité par Poucet Thierry, " Les piliers ou la liberté à cache- cache ", in La Revue Nouvelle, n°3, mars 1999.
Sitographie
Becuwe M., " Aménagez vos espaces de travail pour encourager le collaboratif ", Chef d'entreprise, mis en ligne le 23 juin 2015.
Bismuth D., " L’entreprise libérée, phénomène de fond ou de mode ? ", HBR France, mis en ligne le 15 mai 2015.
Casalegno J-C, " Les entreprises libérées ont-elles une histoire ? ", Les 4 temps du management.
Halary C., " Dans l'entreprise, fini l'autoritarisme, bonjour l'intelligence collective ! ", Capital.fr, mis en ligne le 5 janvier 2015.
MOM
sociocratie.net
igipartners.com
holacracyOne
entreprise-liberee.org
labdsurlholacracy.com
holacracy.org
lexcellenceenholacracy.com
colibris-lemouvement.org
http://cercledesconnaissances.blogspot.be/2013/09/holocratie-un-systeme-de-gouvernance.html
https://entreprisereenchantee.wordpress.com/category/management -3-0/holacratie/
https://coachingentreprise.wordpress.com
http://www.oecd.org
Portail du SPF Economie http://economie.fgov.be
Bismuth D., " L’entreprise libérée, phénomène de fond ou de mode ? ", HBR France, mis en ligne le 15 mai 2015.
Casalegno J-C, " Les entreprises libérées ont-elles une histoire ? ", Les 4 temps du management.
Halary C., " Dans l'entreprise, fini l'autoritarisme, bonjour l'intelligence collective ! ", Capital.fr, mis en ligne le 5 janvier 2015.
MOM
sociocratie.net
igipartners.com
holacracyOne
entreprise-liberee.org
labdsurlholacracy.com
holacracy.org
lexcellenceenholacracy.com
colibris-lemouvement.org
http://cercledesconnaissances.blogspot.be/2013/09/holocratie-un-systeme-de-gouvernance.html
https://entreprisereenchantee.wordpress.com/category/management -3-0/holacratie/
https://coachingentreprise.wordpress.com
http://www.oecd.org
Portail du SPF Economie http://economie.fgov.be
Vidéo
Negui A., Le best-of de la matinale RH Consultancy Partners : Entreprise libérée, mis en ligne le 4 septembre 2015.
Entretien avec Laurent Ledoux, Mindstep TV mis en ligne le 2 septembre 2015.
Entretien avec Jean-François Zobrist, Université d'été des dirigeants Trans-Mutation 2015, mis en ligne le 30 août 2015
Entretien avec Yann Martin, Master Class Management, EM Strasbourg Business School, mise en ligne le 6 décembre 2012.
Entretien avec Brian Robertson " Holacracy : A Radical New Approach to Management ", TEDxGrandRapids, mis en ligne le 02 août 2015.
Entretien avec Bernard Marie Chiquet, L'holacratie : " Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ", Widoobiz, émission de Yannick Le Guern " L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure ", mis en ligne le 18 juin 2013.
Entretien de l'Amiral Olivier Lajous, Université Hommes-Entreprise du CECA, mis en ligne le 28 août 2015.
Entretien avec Laurent Ledoux, Mindstep TV mis en ligne le 2 septembre 2015.
Entretien avec Jean-François Zobrist, Université d'été des dirigeants Trans-Mutation 2015, mis en ligne le 30 août 2015
Entretien avec Yann Martin, Master Class Management, EM Strasbourg Business School, mise en ligne le 6 décembre 2012.
Entretien avec Brian Robertson " Holacracy : A Radical New Approach to Management ", TEDxGrandRapids, mis en ligne le 02 août 2015.
Entretien avec Bernard Marie Chiquet, L'holacratie : " Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ", Widoobiz, émission de Yannick Le Guern " L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure ", mis en ligne le 18 juin 2013.
Entretien de l'Amiral Olivier Lajous, Université Hommes-Entreprise du CECA, mis en ligne le 28 août 2015.
Présentation de l'auteure
Après des études en Anthropologie sociale, Valérie Vandersmissen s'est engagée dans différentes structures associatives et militantes. L'éducation populaire et l'économie sociale sont au coeur de ses pratiques et réflexions. Active au sein d'une coopérative d'emploi, elle termine actuellement un master en sciences du travail à l'Université de Liège.
Notes de bas de pages
(2) Evènement de lancement : Boosting Social Enterprises in Europe, Bruxelles, 9 juillet 2015 : http://www.ripess.eu/fr/category/news-fr/
(3) Parmi les intervenants : Ariane Rodert du Comité Économique et Social européen, Jens Nilsson, eurodéputé et initiateur de l’intergroupe économie sociale du Parlement européen, et Jean-Christophe Burkel, directeur de l’Union Luxembourgeoise de l’Economie Sociale et Solidaire (ULESS), Alain Coheur de Social Economy Europe.
(4) Lebaron F., " Vers une économie du bonheur ? ", Savoir/Agir 3/2009 (n° 9), pp. 133-137
(5) Idem
(6) Voir l'article de Muriel Jasor, " Holocratie : les conditions de succès ", Les Echos, 7 septembre 2015 :
http://m.business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/management/conduite-du-changement/021296283432-entreprisesliberees-les-conditions-de-succes-202561.php
(7) Idem
(3) Parmi les intervenants : Ariane Rodert du Comité Économique et Social européen, Jens Nilsson, eurodéputé et initiateur de l’intergroupe économie sociale du Parlement européen, et Jean-Christophe Burkel, directeur de l’Union Luxembourgeoise de l’Economie Sociale et Solidaire (ULESS), Alain Coheur de Social Economy Europe.
(4) Lebaron F., " Vers une économie du bonheur ? ", Savoir/Agir 3/2009 (n° 9), pp. 133-137
(5) Idem
(6) Voir l'article de Muriel Jasor, " Holocratie : les conditions de succès ", Les Echos, 7 septembre 2015 :
http://m.business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/management/conduite-du-changement/021296283432-entreprisesliberees-les-conditions-de-succes-202561.php
(7) Idem
(13) Rey A. (sous la direction de), Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, 2012.
(15) Idem
(19) Lorent R., Union nationale des mutualités socialistes, cité par Poucet Thierry, " Les piliers ou la liberté à cache- cache ", in La Revue Nouvelle, n°3, mars 1999.
Autres articles

 Accueil
Accueil Ligne éditoriale
Ligne éditoriale



 4.65 L’entreprise libérée - Un nouveau modèle de management pour l’économie sociale ?
4.65 L’entreprise libérée - Un nouveau modèle de management pour l’économie sociale ?


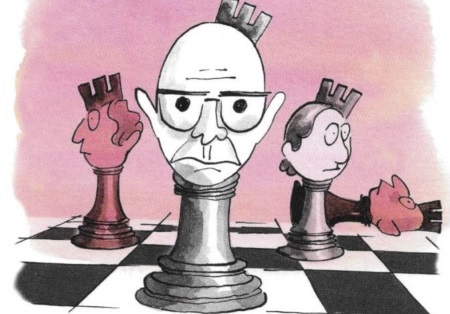











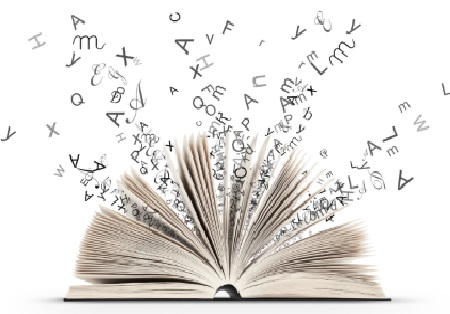












 Accueil
Accueil