Présentation de l'auteur et résumé

Michel Hervé n'est pas un nouveau venu dans le champs de l'innovation managériale. Cela fait plus de 20 ans qu'il expérimente dans son groupe de nouvelles formes de management fondées sur la concertation. Le groupe Hervé réalise un chiffre d'affaire de 465 millions d'euros et rassemble plus de 2700 salariés répartis dans plus de 30 sociétés. Michel Hervé a été par ailleurs député français, député européen, maire de la ville de Parthenay et professeur associé à l'université Paris VIII.
Dans son dernier livre, "Sortir de la culture du chef " (Editions François Bourin), il partage sa vision sur la façon dont l'autorité doit être aujourd'hui mise en oeuvre dans les entreprises. Il plaide pour une approche plus démocratique des relations de pouvoir en invitant les responsables à sortir d'une vision encore trop aristocratique.
C'est en permettant à chacun de faire l'expérience de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et de l'acentralité que les salarié(e)s pourront libérer la créativité dont les entreprises ont désormais besoin pour innover. C'est la condition de leur redéveloppement.
Le lecteur pourra découvrir l'essentiel de sa pensée dans cet article et en écoutant une conférence qu'il a soutenue le 23 Novembre 2018 lors d'une manifestation organisée par le Mastère Spécialisé en GRH et Innovation Sociale du Groupe ESC Clermont, dirigé par Madame Brigitte Nivet, Enseignante Chercheure et co-fondatrice du Groupe de recherche PEOPLE. Cet article est tiré du chapitre VIII de son livre "Réformer l'entreprise" (2015:119 - 144)
Dans son dernier livre, "Sortir de la culture du chef " (Editions François Bourin), il partage sa vision sur la façon dont l'autorité doit être aujourd'hui mise en oeuvre dans les entreprises. Il plaide pour une approche plus démocratique des relations de pouvoir en invitant les responsables à sortir d'une vision encore trop aristocratique.
C'est en permettant à chacun de faire l'expérience de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et de l'acentralité que les salarié(e)s pourront libérer la créativité dont les entreprises ont désormais besoin pour innover. C'est la condition de leur redéveloppement.
Le lecteur pourra découvrir l'essentiel de sa pensée dans cet article et en écoutant une conférence qu'il a soutenue le 23 Novembre 2018 lors d'une manifestation organisée par le Mastère Spécialisé en GRH et Innovation Sociale du Groupe ESC Clermont, dirigé par Madame Brigitte Nivet, Enseignante Chercheure et co-fondatrice du Groupe de recherche PEOPLE. Cet article est tiré du chapitre VIII de son livre "Réformer l'entreprise" (2015:119 - 144)
La nouvelle économie et le nouveau management

La première institution qu'il nous faut réformer, c'est l'entreprise. Si je commence par elle plutôt que par l'État, c'est parce qu'il me semble que l'entreprise est devenue l'institution centrale de nos sociétés et qu'elle occupe dans la nouvelle ère une position aussi importante que l'État dans l'ère précédente. Je précise ici que j'entends par « entreprise» toute organisation non-étatique remplissant une fonction sociale, qu'elle soit à finalité marchande ou non. Je considère donc les associations comme un certain type d'entreprise.
Le capitalisme du XXIe siècle est d'un genre inédit. Il se distingue en effet des quatre types principaux de capitalisme qui l'ont précédé dans l'histoire, comme j'ai eu l'occasion de le développer dans mon livre précédent'. Le premier fut un capitalisme de la force, basé sur une économie de rapine au sein de laquelle dominait la figure du guerrier. Ce qui primait, dans un tel système, c'était le savoir-prendre.
Puis est apparu un capitalisme marchand fondé sur l'échange et sur l'usage de la monnaie. C'est au sein de ce type de capitalisme que la figure du banquier a émergé sur le devant de la scène.
Au XVIII• siècle a fait jour un capitalisme industriel, qui a donné la prééminence au savoir-faire et à la machine. Dans cette économie, le savoir a été principalement appliqué aux instruments, puis peu à peu aux travailleurs.
Ce capitalisme industriel a survécu jusqu'à la fin du XX• siècle, où il a été progressivement suppléé par le capitalisme de la marque, basé sur la communication publicitaire.
Ce n'est que maintenant que nous voyons apparaître un capitalisme de l'adaptation, basé sur l'innovation, l'intelligence intuitive et la conversation informationnelle. C'est un capitalisme cognitif se développant conjointement à une société de l'information. A cet égard, si le marché a autant de pouvoir aujourd'hui, c'est justement parce qu'il permet d'organiser l'activité économique autour de l'information.
Appliquant le savoir au travail, les sociétés occidentales ont accompli une révolution de la productivité. Dans cette économie de la connaissance, les gains de productivité sont obtenus en appliquant le savoir au savoir. Le savoir n'est plus une ressource ; il devient la ressource. L'important n'est plus tant le capital fixe que la capacité d'apprentissage des opérateurs, qui deviennent avant tout des travailleurs du savoir. Si le capitalisme industriel reposait sur la transformation de la matière au moyen d'énergies fossiles, la nouvelle économie repose sur la transformation du savoir et sur les énergies renouvelables.
De même que les énergies fossiles induisaient des formes d'organisation monarchiques, les énergies renouvelables permettent des formes d'organisation acentralisées et participatives. Si tout le monde n'a pas la possibilité physique et financière d'exploiter un gisement de pétrole, tout le monde peut, de manière égalitaire, exploiter les ressources solaire et éolienne. On peut même imaginer, avec Jeremy Rifkin, que d'ici quelques années les citoyens du monde échangeront entre eux de l'énergie autoproduite par le biais des réseaux électriques, de la même manière qu'ils échangent déjà des informations par le biais de réseaux numériques.
Les technologies de l'information et de la communication (TIC) amènent déjà les entreprises à se transformer : en permettant d'économiser la force de travail, d'intégrer les capacités de mémorisation et de calculs dans les machines, elles permettent aux opérateurs de se concentrer sur des tâches de conception et d'innovation. Elles permettent de décentraliser les entreprises, de travailler plus facilement de chez soi, de pouvoir échanger sur des forums ou par mail, de partager l'information, de favoriser la transparence et de gagner en temps et en espace. Bref, les TIC sont en train de transformer le travail en donnant aux travailleurs les moyens de l'autonomie individuelle.
L'économie de l'adaptation fait la part belle au capital immatériel. En effet, une organisa ion est faite de travail physique et mental (employés individuels), de capital matériel (machines, outils) et de capital immatériel. Ce dernier type de capital est le plus mal connu. Il rassemble à la fois des capitaux: proprement humains, tels que les savoir-faire, les faire-savoir et plus encore les savoir-être de chacun, des capitaux: structurels, comme les brevets, les innovations, les secrets de fabrication, les marques déposées, les droits de reproduction et les modèles d'organisation, et enfin le capital relationnel, composé de la clientèle, du fonds de commerce, de la marque et du réseau. C'est ce genre de capitaux: qui tend aujourd'hui à avoir le plus de valeur.
Comme l'avait bien vu Guy Debord, les symboles deviennent plus importants que les objets. De plus en plus, le bien n'est plus que le support d'une image, d'un signe. L'économie de l'immatériel repose sur des intangibles tels que les marques, la réputation, la mise en scène, le storytelling, la communication ou encore les relations publiques. À cette aune, les signes, les savoirs, les images, les concepts et les idées ont souvent davantage de valeur que les choses physiques.
Une des conséquences de ces transformations, c'est la remise en cause de la propriété comme pivot de l'exercice du pouvoir économique. Comme nous l'avons vu lorsque nous avons examiné les sociétés monarchiques, la propriété a été un pilier de la définition de droits politiques et des prérogatives accordées aux dirigeants capitalistes. Mais cela est en train de changer.
Les emplois de demain ne se situent plus tant dans l'industrie que dans l'économie des services, qui emploie déjà les trois quarts des salariés occidentaux. L'industrie était basée sur la relation entre les êtres humains et les choses (ou propriétés). Désormais, ce sont les relations entre êtres humains qui génèrent le plus d'échanges et de valeur.
Je suis également persuadé que la nouvelle ère va faire croître les entreprises non marchandes (culture, sport, social, environnement) et celles fondées sur l'échange informationnel telles que les communautés de développeurs de logiciels gratuits, comme Linux, qui faisaient si peur à Bill Gates du temps de notre expérience commune de ville numérisée, comme je le raconterai plus loin.
Le capitalisme du XXIe siècle est d'un genre inédit. Il se distingue en effet des quatre types principaux de capitalisme qui l'ont précédé dans l'histoire, comme j'ai eu l'occasion de le développer dans mon livre précédent'. Le premier fut un capitalisme de la force, basé sur une économie de rapine au sein de laquelle dominait la figure du guerrier. Ce qui primait, dans un tel système, c'était le savoir-prendre.
Puis est apparu un capitalisme marchand fondé sur l'échange et sur l'usage de la monnaie. C'est au sein de ce type de capitalisme que la figure du banquier a émergé sur le devant de la scène.
Au XVIII• siècle a fait jour un capitalisme industriel, qui a donné la prééminence au savoir-faire et à la machine. Dans cette économie, le savoir a été principalement appliqué aux instruments, puis peu à peu aux travailleurs.
Ce capitalisme industriel a survécu jusqu'à la fin du XX• siècle, où il a été progressivement suppléé par le capitalisme de la marque, basé sur la communication publicitaire.
Ce n'est que maintenant que nous voyons apparaître un capitalisme de l'adaptation, basé sur l'innovation, l'intelligence intuitive et la conversation informationnelle. C'est un capitalisme cognitif se développant conjointement à une société de l'information. A cet égard, si le marché a autant de pouvoir aujourd'hui, c'est justement parce qu'il permet d'organiser l'activité économique autour de l'information.
Appliquant le savoir au travail, les sociétés occidentales ont accompli une révolution de la productivité. Dans cette économie de la connaissance, les gains de productivité sont obtenus en appliquant le savoir au savoir. Le savoir n'est plus une ressource ; il devient la ressource. L'important n'est plus tant le capital fixe que la capacité d'apprentissage des opérateurs, qui deviennent avant tout des travailleurs du savoir. Si le capitalisme industriel reposait sur la transformation de la matière au moyen d'énergies fossiles, la nouvelle économie repose sur la transformation du savoir et sur les énergies renouvelables.
De même que les énergies fossiles induisaient des formes d'organisation monarchiques, les énergies renouvelables permettent des formes d'organisation acentralisées et participatives. Si tout le monde n'a pas la possibilité physique et financière d'exploiter un gisement de pétrole, tout le monde peut, de manière égalitaire, exploiter les ressources solaire et éolienne. On peut même imaginer, avec Jeremy Rifkin, que d'ici quelques années les citoyens du monde échangeront entre eux de l'énergie autoproduite par le biais des réseaux électriques, de la même manière qu'ils échangent déjà des informations par le biais de réseaux numériques.
Les technologies de l'information et de la communication (TIC) amènent déjà les entreprises à se transformer : en permettant d'économiser la force de travail, d'intégrer les capacités de mémorisation et de calculs dans les machines, elles permettent aux opérateurs de se concentrer sur des tâches de conception et d'innovation. Elles permettent de décentraliser les entreprises, de travailler plus facilement de chez soi, de pouvoir échanger sur des forums ou par mail, de partager l'information, de favoriser la transparence et de gagner en temps et en espace. Bref, les TIC sont en train de transformer le travail en donnant aux travailleurs les moyens de l'autonomie individuelle.
L'économie de l'adaptation fait la part belle au capital immatériel. En effet, une organisa ion est faite de travail physique et mental (employés individuels), de capital matériel (machines, outils) et de capital immatériel. Ce dernier type de capital est le plus mal connu. Il rassemble à la fois des capitaux: proprement humains, tels que les savoir-faire, les faire-savoir et plus encore les savoir-être de chacun, des capitaux: structurels, comme les brevets, les innovations, les secrets de fabrication, les marques déposées, les droits de reproduction et les modèles d'organisation, et enfin le capital relationnel, composé de la clientèle, du fonds de commerce, de la marque et du réseau. C'est ce genre de capitaux: qui tend aujourd'hui à avoir le plus de valeur.
Comme l'avait bien vu Guy Debord, les symboles deviennent plus importants que les objets. De plus en plus, le bien n'est plus que le support d'une image, d'un signe. L'économie de l'immatériel repose sur des intangibles tels que les marques, la réputation, la mise en scène, le storytelling, la communication ou encore les relations publiques. À cette aune, les signes, les savoirs, les images, les concepts et les idées ont souvent davantage de valeur que les choses physiques.
Une des conséquences de ces transformations, c'est la remise en cause de la propriété comme pivot de l'exercice du pouvoir économique. Comme nous l'avons vu lorsque nous avons examiné les sociétés monarchiques, la propriété a été un pilier de la définition de droits politiques et des prérogatives accordées aux dirigeants capitalistes. Mais cela est en train de changer.
Les emplois de demain ne se situent plus tant dans l'industrie que dans l'économie des services, qui emploie déjà les trois quarts des salariés occidentaux. L'industrie était basée sur la relation entre les êtres humains et les choses (ou propriétés). Désormais, ce sont les relations entre êtres humains qui génèrent le plus d'échanges et de valeur.
Je suis également persuadé que la nouvelle ère va faire croître les entreprises non marchandes (culture, sport, social, environnement) et celles fondées sur l'échange informationnel telles que les communautés de développeurs de logiciels gratuits, comme Linux, qui faisaient si peur à Bill Gates du temps de notre expérience commune de ville numérisée, comme je le raconterai plus loin.
On peut, sur ce point aussi, renvoyer aux travaux de Jeremy Rifkin sur ce qu'il nomme « l'âge de l'accès ». Selon cette perspective, l'économie se réorganise entre d'un côté des pourvoyeurs et de l'autre des usagers. Les premiers sont toujours des propriétaires de biens matériels ou immatériels, tandis que les seconds y ont accès au moyen de procédures de location, de concession, de leasing, de droits d'admission, d'adhésion ou d'abonnement qui en définissent un usage provisoire. Ainsi, résume Rifkin, « l'échange de biens entre vendeurs et acheteurs - caractéristique centrale de l'économie de marché moderne - est remplacé par un système d'accès à court terme opérant entre des serveurs et des clients organisés en réseaux ». Ce qui fait la valeur d'un bien, c'est donc moins sa propriété que la capacité à le gérer ou à l'utiliser. Avec le leasing par exemple, on gère des infrastructures appartenant à d'autres, et c'est le management qui constitue le véritable créateur de valeur.
Cette nouvelle économie favorise l'émergence de nouveaux modes de consommation, davantage responsables. Le XX• siècle a été le siècle du consommateur. Le XXI• siècle sera celui du citoyen. Le consommateur ne s'intéressait peu, voire pas du tout, à l'histoire du produit et à ses conditions de fabrication. Il se fiait aux marques et sen tenait aux modèles standards. C'était avant tout un propriétaire, un possesseur.
Le citoyen, à l'inverse, consomme de manière éthique. Il désire des produits et des services respectueux de l'environnement et des travailleurs. Il ne se contente pas de suivre des marques mais il cherche à s'en faire un avis informé en se renseignant sur Internet et sur les réseaux sociaux. Ce qu'il recherche, en dernier ressort, ce n'est pas le standard, c'est le sur-mesure, et ce n'est pas la possession, c'est l'usage.
Cette nouvelle économie favorise l'émergence de nouveaux modes de consommation, davantage responsables. Le XX• siècle a été le siècle du consommateur. Le XXI• siècle sera celui du citoyen. Le consommateur ne s'intéressait peu, voire pas du tout, à l'histoire du produit et à ses conditions de fabrication. Il se fiait aux marques et sen tenait aux modèles standards. C'était avant tout un propriétaire, un possesseur.
Le citoyen, à l'inverse, consomme de manière éthique. Il désire des produits et des services respectueux de l'environnement et des travailleurs. Il ne se contente pas de suivre des marques mais il cherche à s'en faire un avis informé en se renseignant sur Internet et sur les réseaux sociaux. Ce qu'il recherche, en dernier ressort, ce n'est pas le standard, c'est le sur-mesure, et ce n'est pas la possession, c'est l'usage.
Favorisant l'éthique de la responsabilité, la consommation responsable se développe particulièrement depuis la fin des années 60 et les premiers « investissements éthiques ». Elle a été renforcée par l'essor du tiers-mondisme, de l'écologisme et des mouvements de consommateurs.
Ainsi même si le gouvernement d'entreprise n'obéit pas forcément à des logiques démocratiques, il est quotidiennement et directement récompensé ou sanctionné par les consommateurs eux-mêmes.
Le célèbre exemple de Nestlé a fait prendre conscience aux entreprises qui en doutaient encore du pouvoir des consommateurs et de leur« conscientisation » croissante. Voilà ce qu'il s'est passé : au début des années 70, Nestlé a lancé une grande campagne marketing en Afrique pour convaincre les jeunes mères que le lait en poudre était meilleur pour la santé de leur enfant que le lait maternel. Et beaucoup l'ont cru. Seulement, ces femmes n'ayant souvent pas accès à l'eau potable, les conséquences ont été désastreuses : des milliers d'enfants sont morts, infectés par des eaux insalubres. Suite à une campagne de boycott des produits Nestlé lancé en 1977 par plusieurs ONG européennes, l'entreprise a perdu près de 20 % de son chiffre d'affaire.
Les principes de transparence et de responsabilité sont ainsi devenus des impératifs pour les entreprises sous le poids des revendications de leurs clients. Nombre de ces sociétés e sont donc récemment emparées de thèmes à la mode comme le développement durable, l'éthique des affaires ou la responsabilité sociale et environnementale des entreprises - quoique à des fins parfois plus cosmétiques qu'éthiques l'entreprise Enron ne possédait-elle pas, par exemple, un Code of Ethics ?
Ainsi même si le gouvernement d'entreprise n'obéit pas forcément à des logiques démocratiques, il est quotidiennement et directement récompensé ou sanctionné par les consommateurs eux-mêmes.
Le célèbre exemple de Nestlé a fait prendre conscience aux entreprises qui en doutaient encore du pouvoir des consommateurs et de leur« conscientisation » croissante. Voilà ce qu'il s'est passé : au début des années 70, Nestlé a lancé une grande campagne marketing en Afrique pour convaincre les jeunes mères que le lait en poudre était meilleur pour la santé de leur enfant que le lait maternel. Et beaucoup l'ont cru. Seulement, ces femmes n'ayant souvent pas accès à l'eau potable, les conséquences ont été désastreuses : des milliers d'enfants sont morts, infectés par des eaux insalubres. Suite à une campagne de boycott des produits Nestlé lancé en 1977 par plusieurs ONG européennes, l'entreprise a perdu près de 20 % de son chiffre d'affaire.
Les principes de transparence et de responsabilité sont ainsi devenus des impératifs pour les entreprises sous le poids des revendications de leurs clients. Nombre de ces sociétés e sont donc récemment emparées de thèmes à la mode comme le développement durable, l'éthique des affaires ou la responsabilité sociale et environnementale des entreprises - quoique à des fins parfois plus cosmétiques qu'éthiques l'entreprise Enron ne possédait-elle pas, par exemple, un Code of Ethics ?
Ce déplacement d'une préoccupation pour la qualité des produits et des services vers la qualité de vie des citoyens reste encore balbutiant, et la plupart des entreprises pensent toujours avec Milton Friedman que « la responsabilité sociale d'une entreprise est d'accroître ses profits".
Il n'en reste pas moins qu'une « triple bottom line » s'impose progressivement aux entreprises : assurer les profits, protéger l'environnement et agir en faveur de la justice sociale. L'enjeu étant de leur faire entendre que ces trois objectifs concordent sur le long terme.
Cela est d'autant plus important que la situation économique est des plus incertaines. Les entreprises sont invitées à s'ouvrir à leurs clients, à adopter les dernières technologies, à se tertiariser et à personnaliser leurs offres, tout en faisant face à une concurrence mondiale. Ne survivront dans cet environnement mouvant et hautement compétitif que les entreprises réactives, flexibles et innovantes. Si bien que le défi central lancé au management n'est plus « comment faire? »mais« que faire? ».
Les entreprises françaises se montrent particulièrement peu adaptées à cette situation, grevées qu'elles sont pour beaucoup par l'inefficacité, le manque d'innovation et la faible qualité. Nombre d'entreprises restent également très pyramidales et trop bureaucratiques, empêtrées dans l'aller-retours entre échelons hiérarchiques, la lourdeur des mécanismes de contrôle et le respect des multiples procédures de validation et d'ëvaluation. Cet excès de taylorisation n'a pas seulement pour effet de ralentir les cycles de production et d'en augmenter les coûts, il est également payé au prix fort par des salariés démotivés, peu impliqués et insuf - fisamment reconnus. C'est le cas des ouvriers autant que des cadres, même si le malaise de ces derniers est moins visible, car les cadres se révoltent non pas massivement, comme le font les ouvriers, « mais sur un mode plus individualiste : stratégies de fuite et de désinvestissement, multiplication des comportements de résistance passive et active, bricolages en tous genres destinés à recréer localement les conditions d'un minimum de confort personnel au travail », ainsi que le relève un sociologue français.
L'entreprise doit donc accomplir une triple mue :
1) Baisser le prix de revient en privilégiant le don et le contre don qu'ont pratiqué avec succès les sociétés !ribales.
2) Parce que notre rareté, c'est l'innovation et que la rareté vous permet d'imposer votre prix, c'est l'innovation qu'il faut réussir à stimuler, en donnant aux salariés les moyens de réaliser des innovations incrémentales, et si possible également des innovations de rupture.
3) Le véritable profit d'une entreprise doit être le bonheur de ses salariés : bonheur d'avoir, bonheur d'être, bonheur d'aimer et d'être aimé.
Rappelez-vous les trois piliers de la philosophie chinoise:
Il n'en reste pas moins qu'une « triple bottom line » s'impose progressivement aux entreprises : assurer les profits, protéger l'environnement et agir en faveur de la justice sociale. L'enjeu étant de leur faire entendre que ces trois objectifs concordent sur le long terme.
Cela est d'autant plus important que la situation économique est des plus incertaines. Les entreprises sont invitées à s'ouvrir à leurs clients, à adopter les dernières technologies, à se tertiariser et à personnaliser leurs offres, tout en faisant face à une concurrence mondiale. Ne survivront dans cet environnement mouvant et hautement compétitif que les entreprises réactives, flexibles et innovantes. Si bien que le défi central lancé au management n'est plus « comment faire? »mais« que faire? ».
Les entreprises françaises se montrent particulièrement peu adaptées à cette situation, grevées qu'elles sont pour beaucoup par l'inefficacité, le manque d'innovation et la faible qualité. Nombre d'entreprises restent également très pyramidales et trop bureaucratiques, empêtrées dans l'aller-retours entre échelons hiérarchiques, la lourdeur des mécanismes de contrôle et le respect des multiples procédures de validation et d'ëvaluation. Cet excès de taylorisation n'a pas seulement pour effet de ralentir les cycles de production et d'en augmenter les coûts, il est également payé au prix fort par des salariés démotivés, peu impliqués et insuf - fisamment reconnus. C'est le cas des ouvriers autant que des cadres, même si le malaise de ces derniers est moins visible, car les cadres se révoltent non pas massivement, comme le font les ouvriers, « mais sur un mode plus individualiste : stratégies de fuite et de désinvestissement, multiplication des comportements de résistance passive et active, bricolages en tous genres destinés à recréer localement les conditions d'un minimum de confort personnel au travail », ainsi que le relève un sociologue français.
L'entreprise doit donc accomplir une triple mue :
1) Baisser le prix de revient en privilégiant le don et le contre don qu'ont pratiqué avec succès les sociétés !ribales.
2) Parce que notre rareté, c'est l'innovation et que la rareté vous permet d'imposer votre prix, c'est l'innovation qu'il faut réussir à stimuler, en donnant aux salariés les moyens de réaliser des innovations incrémentales, et si possible également des innovations de rupture.
3) Le véritable profit d'une entreprise doit être le bonheur de ses salariés : bonheur d'avoir, bonheur d'être, bonheur d'aimer et d'être aimé.
Rappelez-vous les trois piliers de la philosophie chinoise:
- Le taoïsme, ou l'harmonie dans le rapport à l'environnement,
- Le confucianisme, ou l'harmonie dans le rapport à l'autre,
- Le bouddhisme, ou l'harmonie dans le rapport à soi.
C'est cette triple dimension de l'harmonie que nous devons retrouver dans l'entreprise :
- L'harmonie avec l'environnement. Or l'environnement de l'entreprise étant ses clients, les employés doivent être en harmonie avec leurs demandes.
- L'harmonie dans le rapport à l'autre, c'est-à-dire, pour un travailleur, avec ses collègues, son équipe, et l'ensemble de son entreprise.
- L'harmonie dans le rapport à soi. L'entreprise doit donner à chacun le sentiment de son utilité sociale. Chacun de ses membres doit se sentir participer à quelque chose qui a du sens.
En plus d'adapter les entreprises à l'environnement marchand que nous venons de décrire, il faut donc les réformer en profondeur de l'intérieur. La clé de voûte de cette transformation, c'est la démocratie. Il convient ainsi de passer de l'aristocratie autoritaire à la démocratie concertative. Cette forme de démocratie ne doit pas être seulement une vitrine. On ne peut se contenter par exemple d'informer et de consulter les salariés ; il faut également les faire participer aux décisions et leur déléguer véritablement le pouvoir de les appliquer.
Il ne s'agit pas de plaquer sur les entreprises le fonctionnement des États_ occidentaux, ni même pour chacune d'entre elle de copier un modèle de démocratie d'entreprise qui a fait ses preuves ailleurs, mais d'inventer une démocratie concertative ad hoc, adaptée à sa culture et à ses membres.
Le prérequis de cette transformation des entreprises, c'est de sortir d'une approche excessivement utilitaire du travail et du travailleur. Le travail doit retrouver son sens, redevenir un moyen d'expression et de réalisation de soi. En réaction à l'atomisation des salariés et à la parcellisation des tâches, il faut réconcilier managés et managers et raviver le collectif en misant sur sa diversité, son intelligence et sa puissance. Il faut ainsi, par exemple, dans la mesure du possible, privilégier les relations personnalisées, peu formalisées, voire affectives, dont les participants sont pris dans l'intégralité de leur être et non seulement comme professionnels.
L'organisation moderne est un orchestre symphonique, composé en grande partie de spécialistes qui s'auto contrôlent, reçoivent des feedbacks de leurs voisins et sont simplement coordonnés par un référent extérieur chargé de l'harmonie de l'ensemble. Dans ces organisations, le pouvoir n'est pas concentré au sommet de l'organigramme, mais au contraire au plus près de ceux qui ont prise sur l'environnement client.
Les managers de telles organisations sont des catalyseurs qui favorisent l'expression des expériences singulières, positives ou négatives. Ils savent amplifier- l'expression des minoritaires, intensifier la communication virale et favoriser la co-construction de normes consensuelles.
Ces organisations ne comptent plus d'employés, travailleurs du présent en tant que tels, mais uniquement des intra-entrepreneurs qui marient le travail au présent, l'adaptation au futur et la force tribale du groupe. Un intra entrepreneur prend des risques et sait apprendre de ses erreurs, parce qu'il a confiance en son avenir. If voyage, il se déplace, il converse, il échange ce qui lui permet s'apprendre aussi des erreurs des autres. Il est également philosophe, dans la mesure où il s'interroge en permanence, plutôt que d'être uniquement dans la proposition de réponses. Bref, l'intra-entrepreneur est libre, fraternel, égalitaire et acentré.
De fait, la transformation et le fonctionnement de l'entreprise doivent s'appuyer sur les quatre principes cardinaux que nous venons de définir. Ces principes se déclinent en préceptes, et ces préceptes se déclinent en outils. Voyons comment et souvenons-nous, ce faisant, qu'il ne s'agit là que d'indications générales. Car il n'existe pas une seule bonne manière d'organiser une entreprise ou de managerles personnes : chaque cas et chaque individu est différent.
Mes conseils paraîtront à beaucoup irréalistes ou excessifs. Ils ont pourtant fait leur preuve au sein du Groupe Hervé et ils commencent à être adoptés par de plus en plus d'entreprises qui font le pari de miser sur leurs membres plutôt que de les traiter comme des incapables devant être sans répit organisés, contrôlés, rationalisés et optimisés.
Il ne s'agit pas de plaquer sur les entreprises le fonctionnement des États_ occidentaux, ni même pour chacune d'entre elle de copier un modèle de démocratie d'entreprise qui a fait ses preuves ailleurs, mais d'inventer une démocratie concertative ad hoc, adaptée à sa culture et à ses membres.
Le prérequis de cette transformation des entreprises, c'est de sortir d'une approche excessivement utilitaire du travail et du travailleur. Le travail doit retrouver son sens, redevenir un moyen d'expression et de réalisation de soi. En réaction à l'atomisation des salariés et à la parcellisation des tâches, il faut réconcilier managés et managers et raviver le collectif en misant sur sa diversité, son intelligence et sa puissance. Il faut ainsi, par exemple, dans la mesure du possible, privilégier les relations personnalisées, peu formalisées, voire affectives, dont les participants sont pris dans l'intégralité de leur être et non seulement comme professionnels.
L'organisation moderne est un orchestre symphonique, composé en grande partie de spécialistes qui s'auto contrôlent, reçoivent des feedbacks de leurs voisins et sont simplement coordonnés par un référent extérieur chargé de l'harmonie de l'ensemble. Dans ces organisations, le pouvoir n'est pas concentré au sommet de l'organigramme, mais au contraire au plus près de ceux qui ont prise sur l'environnement client.
Les managers de telles organisations sont des catalyseurs qui favorisent l'expression des expériences singulières, positives ou négatives. Ils savent amplifier- l'expression des minoritaires, intensifier la communication virale et favoriser la co-construction de normes consensuelles.
Ces organisations ne comptent plus d'employés, travailleurs du présent en tant que tels, mais uniquement des intra-entrepreneurs qui marient le travail au présent, l'adaptation au futur et la force tribale du groupe. Un intra entrepreneur prend des risques et sait apprendre de ses erreurs, parce qu'il a confiance en son avenir. If voyage, il se déplace, il converse, il échange ce qui lui permet s'apprendre aussi des erreurs des autres. Il est également philosophe, dans la mesure où il s'interroge en permanence, plutôt que d'être uniquement dans la proposition de réponses. Bref, l'intra-entrepreneur est libre, fraternel, égalitaire et acentré.
De fait, la transformation et le fonctionnement de l'entreprise doivent s'appuyer sur les quatre principes cardinaux que nous venons de définir. Ces principes se déclinent en préceptes, et ces préceptes se déclinent en outils. Voyons comment et souvenons-nous, ce faisant, qu'il ne s'agit là que d'indications générales. Car il n'existe pas une seule bonne manière d'organiser une entreprise ou de managerles personnes : chaque cas et chaque individu est différent.
Mes conseils paraîtront à beaucoup irréalistes ou excessifs. Ils ont pourtant fait leur preuve au sein du Groupe Hervé et ils commencent à être adoptés par de plus en plus d'entreprises qui font le pari de miser sur leurs membres plutôt que de les traiter comme des incapables devant être sans répit organisés, contrôlés, rationalisés et optimisés.
L'adaptation innovante

Qu'elle soit marchande ou non, l'entreprise a pour finalité de promouvoir l'adaptation. Pour ce faire, seule la liberté individuelle (auto-entrepreneur) ou collective. (intra-entrepreneurs) permet aux individus et aux groupes de dépasser les contraintes qui les accablent en innovant sans relâche. La liberté, pour moi, c'est le dépassement de la contrainte par l'innovation. En d'autres termes, l'entreprise doit accorder à ses membres ce qu'elle demande pour elle - même : la liberté d'être et d'entreprendre. Cela ne me semble que justice.
On ne peut pas gouverner des travailleurs du savoir, libres et indépendants dans une société en évolution rapide, comme on gouvernait les sociétés agraires ou les sociétés industrielles. tune des spécificités de ces travailleurs du savoir, c'est notamment qu'ils ne peuvent être réellement contrôlés. Ils ont·besoin de liberté pour créer et pour innover. Et ils sont souvent capables de s'auto contrôler.
Il convient donc de ne pas standardiser les individus en voulant tous les faire entrer dans le même moule. Il faut au contraire valoriser leur singularité, leur différence et leur emprunte personnelle sur leur travail. Dans la mesure du possible, il faut éviter les profils de poste ou les profils de carrière. Les salariés acteurs doivent avoir un but commun, mais différentes manières de l'atteindre. Ils doivent avoir des principes communs, mais différentes manières de les interpréter.
Il faut donc favoriser la pédagogie par l'erreur. Comme disait Einstein, « une personne qui n'a jamais commis d'erreurs n'a jamais innové». L'erreur est bonne. Le manager ne doit pas punir la faute, et le managé ne doit pas avoir peur de mal faire ou d'échouer. Quand quelque chose ne va pas, tant mieux : c'est l'occasion de découvrir et d'apprendre. Le seul tort que Ion peut avoir, c'est de n'avoir pas essayé.
Les nouvelles organisations doivent se libérer du stress, qui est une plaie du management actuel, mais aussi de la société tout entière. Aux États-Unis, le coût du stress était évalué en 2000 à 200 milliards de dollars par an et générait la moitié des 500 millions de jours par an d'arrêt de travail.
En situation de stress, comme l'explique mon ami Jacques Fradin, notre cerveau limbique concentre notre attention sur notre vécu, sur nos expériences passées. On ne pense plus, à proprement parler, on paralyse la pensée au profit de la reproduction d'une réaction passée. Ceux qui ont passé des examens en étant très stressés savent que c'est généralement un facteur d'échec. Car le stress inhibe l'inventivité. Le but du dirigeant, ce doit donc être de déstresser ses collaborateurs pour leur permettre de donner le meilleur deux-mêmes. Pour ce faire, il doit notamment renoncer à noter, à punir et à exercer des pressions.
Afin de promouvoir la liberté dans l'entreprise, il faut également favoriser l'initiative personnelle,. l'autonomie, la simplicité et le bon sens, plutôt que la 'référence à des normes et à des procédures exogènes. On peut en ce sens, par exemple, permettre l'appropriation par l'intra-entrepreneur de son univers proche, de ses horaires, de son emploi du temps, de la manière dont est organisé son travail ou de la façon dont il s'habille.
Plus important encore, il faut libérer le salarié des règles infantilisantes, de la paperasse, des contrôles inutiles. Bien plutôt, il faut favoriser l'autocontrôle ainsi que le contrôle par les pairs et par le biais de relations interpersonnelles. Par exemple, chacun devrait avoir la possibilité d'acheter ou de se procurer lui-même les outils dont il a besoin. On devrait même laisser chaque équipe se fixer ses propres objectifs, ses propres stratégies et ses propres rémunérations. Ce faisant, elle connaîtra mieux ses coûts et ses bénéfices et se sentira davantage responsable envers les autres équipes constituant l'entreprise.
On ne peut pas gouverner des travailleurs du savoir, libres et indépendants dans une société en évolution rapide, comme on gouvernait les sociétés agraires ou les sociétés industrielles. tune des spécificités de ces travailleurs du savoir, c'est notamment qu'ils ne peuvent être réellement contrôlés. Ils ont·besoin de liberté pour créer et pour innover. Et ils sont souvent capables de s'auto contrôler.
Il convient donc de ne pas standardiser les individus en voulant tous les faire entrer dans le même moule. Il faut au contraire valoriser leur singularité, leur différence et leur emprunte personnelle sur leur travail. Dans la mesure du possible, il faut éviter les profils de poste ou les profils de carrière. Les salariés acteurs doivent avoir un but commun, mais différentes manières de l'atteindre. Ils doivent avoir des principes communs, mais différentes manières de les interpréter.
Il faut donc favoriser la pédagogie par l'erreur. Comme disait Einstein, « une personne qui n'a jamais commis d'erreurs n'a jamais innové». L'erreur est bonne. Le manager ne doit pas punir la faute, et le managé ne doit pas avoir peur de mal faire ou d'échouer. Quand quelque chose ne va pas, tant mieux : c'est l'occasion de découvrir et d'apprendre. Le seul tort que Ion peut avoir, c'est de n'avoir pas essayé.
Les nouvelles organisations doivent se libérer du stress, qui est une plaie du management actuel, mais aussi de la société tout entière. Aux États-Unis, le coût du stress était évalué en 2000 à 200 milliards de dollars par an et générait la moitié des 500 millions de jours par an d'arrêt de travail.
En situation de stress, comme l'explique mon ami Jacques Fradin, notre cerveau limbique concentre notre attention sur notre vécu, sur nos expériences passées. On ne pense plus, à proprement parler, on paralyse la pensée au profit de la reproduction d'une réaction passée. Ceux qui ont passé des examens en étant très stressés savent que c'est généralement un facteur d'échec. Car le stress inhibe l'inventivité. Le but du dirigeant, ce doit donc être de déstresser ses collaborateurs pour leur permettre de donner le meilleur deux-mêmes. Pour ce faire, il doit notamment renoncer à noter, à punir et à exercer des pressions.
Afin de promouvoir la liberté dans l'entreprise, il faut également favoriser l'initiative personnelle,. l'autonomie, la simplicité et le bon sens, plutôt que la 'référence à des normes et à des procédures exogènes. On peut en ce sens, par exemple, permettre l'appropriation par l'intra-entrepreneur de son univers proche, de ses horaires, de son emploi du temps, de la manière dont est organisé son travail ou de la façon dont il s'habille.
Plus important encore, il faut libérer le salarié des règles infantilisantes, de la paperasse, des contrôles inutiles. Bien plutôt, il faut favoriser l'autocontrôle ainsi que le contrôle par les pairs et par le biais de relations interpersonnelles. Par exemple, chacun devrait avoir la possibilité d'acheter ou de se procurer lui-même les outils dont il a besoin. On devrait même laisser chaque équipe se fixer ses propres objectifs, ses propres stratégies et ses propres rémunérations. Ce faisant, elle connaîtra mieux ses coûts et ses bénéfices et se sentira davantage responsable envers les autres équipes constituant l'entreprise.
Selon un principe de subsidiarité, les problèmes doivent être résolus là où ils se posent et par ceux qui les connaissent le mieux. Dans ma vie professionnelle, je suis toujours parti du principe que ceux qui sont en haut de la pyramide n'en savent pas plus que ceux qui sont en bas - et qu'ils en savent même souvent moins. Ceux qui savent, ce sont ceux qui font. Interdisons donc aux responsables d'intervenir au niveau n-2.
Chaque représentant ne devrait avoir de mandat décisionnaire qu'en ce qui concerne ceux qu'il représente directement. Il est important que le management se force à _ne pas solutionner les problèmes que peuvent résoudre directement ses collaborateurs. Même si cela peut se révéler très frustrant, les superviseurs doivent apprendre à poser des questions plutôt que se croire obligés d'apporter des solutions toutes faites aux collaborateurs qui ont un défi à relever.
Pareillement, les salariés ont d'ordinaire une meilleure compréhension de leur entreprise et une vision davantage à long terme que les actionnaires. Laissons-les donc décider de la stratégie générale de l'entreprise, à court et à long terme. Enfin, parce que nous ne sommes pas tous motivés par les mêmes choses, la subsidiarité permet à chaque salarié entrepreneur de se fixer les objectifs qui le stimulent le plus. Ceux qui travaillent le mieux sont ceux qui le font pour des raisons personnelles. Plus vous vous adressez aux diffé-rentes facettes d'un individu, plus vous suscitez son intérêt et sa motivation. Cela peut paraître un truisme, et pourtant beaucoup d'entreprises et de cadres traitent leurs employés comme s'ils étaient tous motivés par. deux choses uniquement : la promotion et la prime. Autrement dit : le pouvoir et l'argent.
Ces motivations externes ne valent qu'un temps. La prime et la promotion sont vite oubliées. Tandis que la motivation interne, autonome, qui ne nécessite pas l'intervention d'un agent extérieur, peut durer des mois, des années, et souvent même toute une vie.
Chaque représentant ne devrait avoir de mandat décisionnaire qu'en ce qui concerne ceux qu'il représente directement. Il est important que le management se force à _ne pas solutionner les problèmes que peuvent résoudre directement ses collaborateurs. Même si cela peut se révéler très frustrant, les superviseurs doivent apprendre à poser des questions plutôt que se croire obligés d'apporter des solutions toutes faites aux collaborateurs qui ont un défi à relever.
Pareillement, les salariés ont d'ordinaire une meilleure compréhension de leur entreprise et une vision davantage à long terme que les actionnaires. Laissons-les donc décider de la stratégie générale de l'entreprise, à court et à long terme. Enfin, parce que nous ne sommes pas tous motivés par les mêmes choses, la subsidiarité permet à chaque salarié entrepreneur de se fixer les objectifs qui le stimulent le plus. Ceux qui travaillent le mieux sont ceux qui le font pour des raisons personnelles. Plus vous vous adressez aux diffé-rentes facettes d'un individu, plus vous suscitez son intérêt et sa motivation. Cela peut paraître un truisme, et pourtant beaucoup d'entreprises et de cadres traitent leurs employés comme s'ils étaient tous motivés par. deux choses uniquement : la promotion et la prime. Autrement dit : le pouvoir et l'argent.
Ces motivations externes ne valent qu'un temps. La prime et la promotion sont vite oubliées. Tandis que la motivation interne, autonome, qui ne nécessite pas l'intervention d'un agent extérieur, peut durer des mois, des années, et souvent même toute une vie.
La force du collectif

La cellule de base d'une organisation, c'est le groupe. Il compte entre huit et vingt personnes se rassemblant régulièrement. Les membres d'une organisation moderne doivent être avant tout membres de tels groupes restreints et fraternels. Les organisations doivent donner de l'importance aux pairs au détriment des pères. Par exemple, c'est le groupe des pairs, et non le leader, qui doit régler les conflits. Plutôt que de restreindre la résolution du problème à un tête-à tête entre un encadrant et un subordonné - tête-à-tête dans lequel le supérieur aura toujours le dessus et le subordonné le sentiment d'être toujours la victime -, il faut élargir le cercle des médiateurs.
·
Notons, à cet égard, qu'il ne faut jamais mettre les conflits et les différends sous le tapis. Il convient au contraire de savoir en détecter les signaux faibles et braquer dessus les projecteurs. Chaque conflit doit être l'occasion d'apprendre de ses pairs. Dans la mesure du possible, chaque obstacle professionnel devrait être résolu par un opérateur en allant chercher la solution chez ses collègues et non auprès d'un n+l.
Non seulement le groupe est un formidable réservoir de savoirs, d'expériences et de contacts, mais le fait de réfléchir ensemble démultiplie le champ d'application de ce savoir&, de ces expériences et de ces contacts. L' intelligence collective est une émulation collective, que l'on pourrait résumer par l'équation : 1 + 1 = 3. L'innovation ordinaire, ainsi que je l'appelle, désigne cette capacité à capter l'inventivité de tous et pas uniquement de ceux qui sont payés pour faire de la recherche et du développement. I.:autre doit permettre à chacun de se dépasser et d'aller plus loin. Chacun doit ainsi reconnaître qu'il a besoin des autres et de leurs retours sur ce qu'il fait pour mieux se connaître lui-même.
·
Notons, à cet égard, qu'il ne faut jamais mettre les conflits et les différends sous le tapis. Il convient au contraire de savoir en détecter les signaux faibles et braquer dessus les projecteurs. Chaque conflit doit être l'occasion d'apprendre de ses pairs. Dans la mesure du possible, chaque obstacle professionnel devrait être résolu par un opérateur en allant chercher la solution chez ses collègues et non auprès d'un n+l.
Non seulement le groupe est un formidable réservoir de savoirs, d'expériences et de contacts, mais le fait de réfléchir ensemble démultiplie le champ d'application de ce savoir&, de ces expériences et de ces contacts. L' intelligence collective est une émulation collective, que l'on pourrait résumer par l'équation : 1 + 1 = 3. L'innovation ordinaire, ainsi que je l'appelle, désigne cette capacité à capter l'inventivité de tous et pas uniquement de ceux qui sont payés pour faire de la recherche et du développement. I.:autre doit permettre à chacun de se dépasser et d'aller plus loin. Chacun doit ainsi reconnaître qu'il a besoin des autres et de leurs retours sur ce qu'il fait pour mieux se connaître lui-même.
Le principal prérequis à la participation de tous, c'est la disponibilité de l'information. Il faut à tout prix éviter le management par rétention d'informations. Chacun doit ainsi travailler à se rendre aussi transparent que possible en rendant son action visible et lisible par le plus grand nombre. Tout le monde peut être informé et tout le monde peut s'exprimer : c'est une règle que j'ai toujours faite prévaloir dans mon entreprise et dans mes fonctions publiques.
Mais rendre l'information disponible ne suffit pas. Il faut également la rendre compréhensible, et cela nécéssite de former les collaborateurs. Leur montée perpétuelle en compétence doit leur permettre de contextualiser les informations dont ils disposent et de les lier à d'autres, de manière à les questionner, à les mettre en débat et à innover. La transparence et la formation permettent ainsi de créer de l'agilité individuelle et collective en favorisant une meilleure intelligence des situations et des opportunités. Ainsi, toutes les demandes de formation sont acceptées, dans la limite des moyens disponibles, même si elles ne répondent pas direc - tement à un besoin identifié de l'organisation. C'est le pari de la pédagogie : pour peu qu'on leur en donne les moyens, les gens apprennent et comprennent.
Mais rendre l'information disponible ne suffit pas. Il faut également la rendre compréhensible, et cela nécéssite de former les collaborateurs. Leur montée perpétuelle en compétence doit leur permettre de contextualiser les informations dont ils disposent et de les lier à d'autres, de manière à les questionner, à les mettre en débat et à innover. La transparence et la formation permettent ainsi de créer de l'agilité individuelle et collective en favorisant une meilleure intelligence des situations et des opportunités. Ainsi, toutes les demandes de formation sont acceptées, dans la limite des moyens disponibles, même si elles ne répondent pas direc - tement à un besoin identifié de l'organisation. C'est le pari de la pédagogie : pour peu qu'on leur en donne les moyens, les gens apprennent et comprennent.
Je n'ai jamais été convaincu des vertus de la mise en concurrence des individus au sein des équipes. J'ai toujours fait l'expérience, au contraire, que l'entraide et le service mutuel n'avaient que des effets positifs. C'est pourquoi je recommande systématiquement aux dirigeants que je rencontre de récompenser la mise au service des autres, l'utilité sociale et l'aide au collègue dans le besoin. Il faut être dans l'innovation et la liberté par rapport à l'environnement et par rapport aux concurrents, tout en étant dans la fraternité, l'égalité et le commun avec ses équipes.
Il convient ainsi de passer du consultatif au concertatif. Il faut non seulement réfléchir ensemble, mais aussi décider ensemble. Non pas col-laborer, (du latin labor, «travail») mais co-opérer (du latin opus,« œuvre »).Donner la possibilité à quelqu'un de s'exprimer sans lui donner la possibilité de décider est souvent extrêmement frustrant.
La démocratie participative est, hélas, trop souvent réduite à un sondage d'opinion, sans redistribution réelle des pouvoirs. Les dirigeants demandent aux uns et aux autres leur avis, puis ils décident comme bon leur semble. Une véritable démocratie participative est un régime dans lequel chacun peut co-décider des fins collectives. Et elle permet à ces décisions d'être prises au plus près de leur lieu d'application. De telles décisions collectives, ai-je remarqué; sont à la fois plus pertinentes, moins partiales, moins partielles et mieux appliquées.
Dans l'idéal, les décisions ne sont pas le résultat de compromis, pour lesquels chacun lâche quelque chose, mais de la coordination, qui consiste à inventer une solution qui convient à tous. Lors de la prise de décision, l'autorité des arguments doit primer sur l'argument d'autorité. Ce n'est pas celui qui parle le plus fort, le plus souvent ou le plus doctement qui doit emporter la mise, mais c'est le groupe tout entier qui doit parvenir à une décision quasi unanime. Personne ne devrait jamais pouvoir imposer sa décision au sein d'un groupe.
Dans une entreprise aristocratique, même s'il peut consulter les autres, c'est le chef qui a le dernier mot. Dans une démocratie participative, c'est l'équipe qui a le dernier mot. Le représentant apporte des arguments contextuels utiles à la prise de décision, mais la décision est collective, à l'unanimité ou à la majorité des 80/20, voire des trois-quarts. L'unanimité est difficilement atteignable, mais quand la minorité est aussi réduite, elle accepte sans peine la décision de la majorité et fait taire ses réserves.
Il faut ainsi, en somme, favoriser systématiquement le collectif. Si tant est qu'il y ait des représentants, par exemple, ils devraient être choisis collectivement. Aussi souvent que possible, !effort individuel devrait être restitué dans la perspective du groupe, celui du groupe dans la perspective de l'entreprise, et celui de l'entreprise dans la perspective de la société. C'est là l'un des rôles clés de l'encadrement : aider à rendre visible le pourquoi, donner du sens, faire sourdre la signification de l'effort collectif.
Il convient ainsi de passer du consultatif au concertatif. Il faut non seulement réfléchir ensemble, mais aussi décider ensemble. Non pas col-laborer, (du latin labor, «travail») mais co-opérer (du latin opus,« œuvre »).Donner la possibilité à quelqu'un de s'exprimer sans lui donner la possibilité de décider est souvent extrêmement frustrant.
La démocratie participative est, hélas, trop souvent réduite à un sondage d'opinion, sans redistribution réelle des pouvoirs. Les dirigeants demandent aux uns et aux autres leur avis, puis ils décident comme bon leur semble. Une véritable démocratie participative est un régime dans lequel chacun peut co-décider des fins collectives. Et elle permet à ces décisions d'être prises au plus près de leur lieu d'application. De telles décisions collectives, ai-je remarqué; sont à la fois plus pertinentes, moins partiales, moins partielles et mieux appliquées.
Dans l'idéal, les décisions ne sont pas le résultat de compromis, pour lesquels chacun lâche quelque chose, mais de la coordination, qui consiste à inventer une solution qui convient à tous. Lors de la prise de décision, l'autorité des arguments doit primer sur l'argument d'autorité. Ce n'est pas celui qui parle le plus fort, le plus souvent ou le plus doctement qui doit emporter la mise, mais c'est le groupe tout entier qui doit parvenir à une décision quasi unanime. Personne ne devrait jamais pouvoir imposer sa décision au sein d'un groupe.
Dans une entreprise aristocratique, même s'il peut consulter les autres, c'est le chef qui a le dernier mot. Dans une démocratie participative, c'est l'équipe qui a le dernier mot. Le représentant apporte des arguments contextuels utiles à la prise de décision, mais la décision est collective, à l'unanimité ou à la majorité des 80/20, voire des trois-quarts. L'unanimité est difficilement atteignable, mais quand la minorité est aussi réduite, elle accepte sans peine la décision de la majorité et fait taire ses réserves.
Il faut ainsi, en somme, favoriser systématiquement le collectif. Si tant est qu'il y ait des représentants, par exemple, ils devraient être choisis collectivement. Aussi souvent que possible, !effort individuel devrait être restitué dans la perspective du groupe, celui du groupe dans la perspective de l'entreprise, et celui de l'entreprise dans la perspective de la société. C'est là l'un des rôles clés de l'encadrement : aider à rendre visible le pourquoi, donner du sens, faire sourdre la signification de l'effort collectif.
L'échange : don et contre don
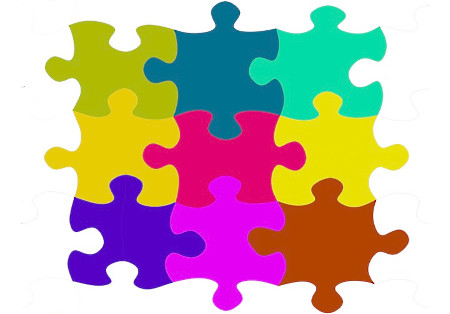
En laissant la liberté et la fraternité se déployer dans l'entreprise, nous favorisons l'égalité. I.:instauration de relations de travail égalitaires requiert toutefois quelques mesures complémentaires.
Il est ainsi important,d'encourager, à tous les échelons de l'entreprise, l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les vieux, entre les nouveaux et les anciens. Il faut également rejeter les titres, les privilèges et les symboles de distinction entre les dirigeants et les autres, tels que les bureaux spacieux et les places de parking réservés à la direction. Plus encore, il faut garantir la transparence des rémunérations et des avantages - qui ne font .généralement débat que lorsque les différences paraissent anormales pàr rapport à la culture dominante dans l'entreprise ou au sein de la société en général.
Il est par exemple possible de réduire la division du travail et la spécialisation excessive, en organisant la polyvalence et la rotation des postes. Il nous faut, en ce sens, retrouver la faible division du travail qui prévalait chez les peuples primitifs. Chacun devrait, par exemple, avoir la possibilité de constituer des groupes de travail autour d'une idée mobilisatrice. On peut également favoriser la diversité des opinions et des comportements en protégeant et en encourageant ceux qui expriment une opinion différente, en affirmant par exemple que tout doit être questionné, même de manière farfelue. Au sein de mon groupe, par exemple, je n'hésite jamais à inviter des personnes venant d'horizons différents (militants associatifs, artistes, philosophes, chercheurs), qui vont émettre des avis très originaux sur notre travail et favoriser l'expression des employés les plus en retrait.
L'entreprise doit également promouvoir la réalisation de soi et du projet personnel de ses membres. tes salariés devraient, dans la mesure du possible, faire ce pour quoi ils sont bons et se concentrer sur les domaines dans lesquels ils apportent une réelle valeur ajoutée. Comme nous le disions plus haut, il ne faut pas vouloir les faire rentrer de force dans des cases. L'épanouissement individuel passe par la reconnaissance de l'utilité sociale de chacun. I.:entreprise doit être ainsi pleinement ouverte sur la société et consciente du rôle constructif qu'elle y joue. La responsabilité sociale vaut pour l'entreprise en général et pour les employés en particulier.
On parle depuis peu de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), mais l'idée que l'entreprise, le salarié et la société ont des intérêts communs a été soulevée très tôt, par des socialistes comme Saint-Simon et Fourier, par exemple, mais également par des économistes classiques tels qui\.dam Smith et David Ricardo. Pour ma part, j'ai toujours trouvé nécessaire d'encastrer !entreprise dans la société. Cest vrai aussi du marché, dont Karl Polanyi a montré quels dégâts il pouvait produire quand il était « désenchâssé » des structures sociales.
En retour, les salariés doivent accepter de se changer eux-mêmes et accepter l'aide des autres. Chacun doit, quand c'est nécessaire, reconnaître ses erreurs et ses limites. Les rapports interpersonnels doivent être ainsi emprunts de bienveillance. Il faut que nous prenions soin les uns des autres. Aux XVIIIe et XIXe siècles, le terme « management» est, du reste, synonyme de« soin». Le management consiste alors à faire croître, à développer des potentialités, à accompagner un être vers la maturité. C'est un sens qu'il nous faut retrouver aujourd'hui. Le management doit viser à l'épanouissement de chacun, et non à son contrôle et à sa discipline. Je favorise ainsi, par exemple, l'instauration de parrainages verticaux (seniors / juniors) et horizontaux (entre pairs).
Les parrainages verticaux consistent ainsi à proposer à chaque nouvelle recrue d'être accompagnée par un salarié ayant de l'ancienneté. Le parrain fait ainsi bénéficier son filleul de son expérience, de sa connaissance de l'entreprise et de ses réseaux personnels, sans être avec lui dans un rapport hiérarchique. C'est une pratique courante dans les entreprises démocratiques, qui permet aux nouveaux venus de s'approprier plus rapidement la culture de l'entreprise et de bénéficier de conseils généraux. Le parrain n'e t pas là pour résoudre des problèmes opérationnels, mais pour permettre à son filleul de progresser au mieux dans l'entreprise, d'identifier des opportunités et de bénéficier de précieux contacts.
Il est ainsi important,d'encourager, à tous les échelons de l'entreprise, l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les vieux, entre les nouveaux et les anciens. Il faut également rejeter les titres, les privilèges et les symboles de distinction entre les dirigeants et les autres, tels que les bureaux spacieux et les places de parking réservés à la direction. Plus encore, il faut garantir la transparence des rémunérations et des avantages - qui ne font .généralement débat que lorsque les différences paraissent anormales pàr rapport à la culture dominante dans l'entreprise ou au sein de la société en général.
Il est par exemple possible de réduire la division du travail et la spécialisation excessive, en organisant la polyvalence et la rotation des postes. Il nous faut, en ce sens, retrouver la faible division du travail qui prévalait chez les peuples primitifs. Chacun devrait, par exemple, avoir la possibilité de constituer des groupes de travail autour d'une idée mobilisatrice. On peut également favoriser la diversité des opinions et des comportements en protégeant et en encourageant ceux qui expriment une opinion différente, en affirmant par exemple que tout doit être questionné, même de manière farfelue. Au sein de mon groupe, par exemple, je n'hésite jamais à inviter des personnes venant d'horizons différents (militants associatifs, artistes, philosophes, chercheurs), qui vont émettre des avis très originaux sur notre travail et favoriser l'expression des employés les plus en retrait.
L'entreprise doit également promouvoir la réalisation de soi et du projet personnel de ses membres. tes salariés devraient, dans la mesure du possible, faire ce pour quoi ils sont bons et se concentrer sur les domaines dans lesquels ils apportent une réelle valeur ajoutée. Comme nous le disions plus haut, il ne faut pas vouloir les faire rentrer de force dans des cases. L'épanouissement individuel passe par la reconnaissance de l'utilité sociale de chacun. I.:entreprise doit être ainsi pleinement ouverte sur la société et consciente du rôle constructif qu'elle y joue. La responsabilité sociale vaut pour l'entreprise en général et pour les employés en particulier.
On parle depuis peu de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), mais l'idée que l'entreprise, le salarié et la société ont des intérêts communs a été soulevée très tôt, par des socialistes comme Saint-Simon et Fourier, par exemple, mais également par des économistes classiques tels qui\.dam Smith et David Ricardo. Pour ma part, j'ai toujours trouvé nécessaire d'encastrer !entreprise dans la société. Cest vrai aussi du marché, dont Karl Polanyi a montré quels dégâts il pouvait produire quand il était « désenchâssé » des structures sociales.
En retour, les salariés doivent accepter de se changer eux-mêmes et accepter l'aide des autres. Chacun doit, quand c'est nécessaire, reconnaître ses erreurs et ses limites. Les rapports interpersonnels doivent être ainsi emprunts de bienveillance. Il faut que nous prenions soin les uns des autres. Aux XVIIIe et XIXe siècles, le terme « management» est, du reste, synonyme de« soin». Le management consiste alors à faire croître, à développer des potentialités, à accompagner un être vers la maturité. C'est un sens qu'il nous faut retrouver aujourd'hui. Le management doit viser à l'épanouissement de chacun, et non à son contrôle et à sa discipline. Je favorise ainsi, par exemple, l'instauration de parrainages verticaux (seniors / juniors) et horizontaux (entre pairs).
Les parrainages verticaux consistent ainsi à proposer à chaque nouvelle recrue d'être accompagnée par un salarié ayant de l'ancienneté. Le parrain fait ainsi bénéficier son filleul de son expérience, de sa connaissance de l'entreprise et de ses réseaux personnels, sans être avec lui dans un rapport hiérarchique. C'est une pratique courante dans les entreprises démocratiques, qui permet aux nouveaux venus de s'approprier plus rapidement la culture de l'entreprise et de bénéficier de conseils généraux. Le parrain n'e t pas là pour résoudre des problèmes opérationnels, mais pour permettre à son filleul de progresser au mieux dans l'entreprise, d'identifier des opportunités et de bénéficier de précieux contacts.
La logique effectuale
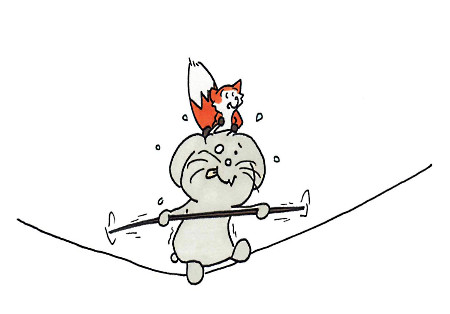
Centrer sur un but pour réussir à tout prix est le propre de l'éducation à l'obéissance que nous avons reçue et souvent le signe d'un manque de confiance en soi. La vraie réussite consiste à prendre du recul. Ce n'est plus une logique prédictive mais une logique effectuale et acentrée qui permet de faire le chemin en marchant, afin de saisir toutes les opportunités dont nous avons besoin et afin de favoriser l'aptitude à vivre dans la diversité et l'anticonformisme. Nos entreprises meurent du comportement moutonnier de leurs dirigeants et de leurs employés. N'est-ce pas précisément ce qu'il s'est passé en 2008 ? Tout le monde a fait les mêmes erreurs, et ceux qui ont tiré la sonnette d'alarme se sont vus traiter de mauvais augure.
·
Au sein du Groupe Hervé, nous ne promouvons pas seulement la diversité culturelle, mais aussi la diversité générationnelle. Nous sommes convaincus, . parce que nous l'avons vu concrètement fonctionner, que les jeunes nouveaux font bouger les anciens, mais que la réciproque est aussi vraie. Plutôt que de bâtir des cloisons entre ces deux groupes générationnels, il faut au contraire multiplier les occasions de collaboration. Il faut également promouvoir la diversité géographique, sociale et ethnique, ainsi que l'emploi des personnes en situation de handicap.
Dans l'idéal, comme je le disais plus haut, la stratégie d'une entreprise devrait être définie par ses employés: l'entreprise devient alors ce que les salariés en font au gré de leurs désirs et des opportunités techniques ou commerciales. Nous devons être dans une logique effectuale (adaptation des fins aux moyens) plutôt que dans une logique prédictive (adaptation des moyens aux fins). C'est ce que j'appelle la méthode agile. Elle consiste, pour une entreprise, une équipe ou un individu, à s'adapter au fil du projet, en prenant en compte les signaux faibles et en étant à l'écoute des clients. Une telle méthode permet d'avancer pas à pas, de manière incrémentale, plutôt que de foncer tête baissée vers des objectifs prédéfinis par la direction.
C'est un autre aspect du principe de subsidiarité, auquel je tiens beaucoup: il faut laisser la décision aux opérateurs. Comme je le disais plus haut, ceux qui font sont ceux qui savent. Dans les sociétés du Groupe Hervé par exemple,
nous avons proposé à nos soudeurs et à nos chaudronniers d'aller voir le robot-soudeur que venait de commercialiser Air Liquide. Les soudeurs sont des professionnels qui tirent une grande fierté de leur savoir-faire. Suite à leur découverte du robot, ils ont décidé de l'adopter, notamment pour réduire la pénibilité de leurs tâches. Ils ont ainsi accepté d'être moins payés pour pouvoir s'offrir ce robot, et une fois qu'il a été installé, ils se sont redécouverts en travailleurs intellectuels.
S'ils ont pu faire ce chemin, c'est qu'ils avaient confiance en eux. La confiance en soi induit l'autonomie, la coopération et le plaisir de travailler en équipe. Elle favorise l'auto-évaluation et l'autocontrôle. En revanche, le manque de confiance en soi induit la peur de l'échec et le besoin d'appuis subsidiaires, en l'occurrence le manager catalyseur et le pair. La fausse confiance, quant à elle, conduit à une mauvaise évaluation du risque, au déni de ses erreurs, à la compétition, à la manipulation, au secret et à l'opacité. En situation de fausse confiance, les individus ont besoin de se rattacher à leur histoire et de se mentir en se disant : « vous vous souvenez quand on était les meilleurs, on avait gagné ceci et cela. » Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, cette attitude de repli sur son passé conduit à l'immobilisme et à l'aveuglement. À cet égard, la fausse confiance est beaucoup plus préjudiciable à l'entreprise que le manque de confiance en soi.
Laissez-moi vous raconter cette anecdote : j'ai mis très tôt des ordinateurs à disposition des ouvriers, notamment pour leur permettre de pouvoir émettre eux-mêmes leurs bons de commande. Ils étaient très fiers de disposer d'ordinateurs, et pourtant ils se cachaient dans leur voiture pour les utiliser. Intrigué par cette pratique, je me suis renseigné et j'ai découvert qu'ils faisaient ainsi parce qu'ils avaient l'impression qu'utiliser un ordinateur revenait à trahir la classe ouvrière. Quand ils se sont rendus compte que les autres ouvriers les enviaient, ils se sont mis à sortir leur ordinateur de leur voiture. Et l'obstacle qu'il a fallu désamorcer ensuite, ce furent les cadres du Groupe Hervé, pour lesquels la possession d'un ordinateur ne constituait plus un moyen de se rehausser vis-à-vis des opérateurs. Il nous a fallu alors leur rappeler qu'ils devaient tirer leur fierté du travail accompli, et non de leur équipement technique ou d'autres signes extérieurs de richesse.
Dans un cas comme dans l'autre, ce que l'on voit à l'œuvre, c'est de la fausse confiance. Un travailleur doit trouver de la fierté dans son travail et dans sa contribution au groupe, plutôt que dans la simple possession d'un objet ou d'un titre ronflant que les autres n'ont pas. C'est cette vanité et cette fausse confiance en soi qui débouchent sur la compétition, que nous avons dû vaincre hier avec les ouvriers et les cadres, et que nous continuons à combattre aujourd'hui car elles renaissent facilement.
Pis, dans certaines entreprises, c s comportements sont encouragés. On dit à chaque échelon qu'il vaut mieux que celui du dessous et moins bien que celui du dessus. On incite également les employés à assimiler leur fonction et leur salaire à leur poste, et non à leur contribution au collectif. On met l'accent sur les signes extérieurs de réussite, la gamme des voitures de fonction, la taille des bureaux, la marque du téléphone portable. Et surtout, on fait de la hiérarchie une fin en elle-même. Beaucoup de dirigeants qui ont entrepris d'« aplatir » leur pyramide hiérarchique m'ont confié à cet égard que nombre de salariés s'y opposaient, parce qu'ils avaient l'impression que cela remettait en cause leur identité même.
Lorsqu'on travaille dans des systèmes horizontaux, on n'a plus à craindre cela. Car, dès lors, ce n'est plus le sommet qui est le point de référence des identités et des fonctions, mais la manière dont chacun contribue à l'effort général, quels que soient sa place dans l'organigramme, ses diplômes ou le prix de son ordinateur.
Voilà, en résumé, comment les quatre principes cardinaux que j'ai identifiés comme formant le cœur de la nouvelle ère peuvent être mis en application pour transformer les entreprises. Vous l'aurez remarqué, ces principes font système et ne sauraient aller l'un sans l'autre. Par exemple, l'épanouissement personnel est tributaire de la solidarité et de la responsabilité; il ne peut y avoir de bien-être personnel sans bien commun ; pour pouvoir décider et être responsable, il faut être compétent et informé ; la participation, de même, favorise l'esprit d'équipe, la responsabilité et la compétence. La démocratisation d'une entreprise consiste ainsi· à tenir ensemble ces principes.
Enfin, et ce n'est pas sans importance, ces principes donnent des résultats : favoriser une plus grande autonomie des travailleurs, c'est accroître leur réactivité et leur proximité au client ; rehausser les compétences de chacun, c'est multiplier leur efficacité ; leur donner des responsabilités, c'est favoriser leur engagement et leur motivation; ; garantir une transparence totale, c'est augmenter la rapidité des déci sions ; et permettre aux employés de prendre soin d'eux et de leurs collègues, c'est accroître le bien-être et la résilience de tous. Les entreprises mettant en œuvre la démocratie concertative sont ainsi généralement plus innovantes et plus résilientes, et elles connaissent moins de jours d'arrêts maladie, moins d'accidents du travail et une plus forte croissance.
Pour autant, ne nous voilons pas la face : ce système démocratique peut avoir ses limites. Il impose parfois un changement complet de la culture de l'entreprise, ce qui ne va pas sans vives réactions de certains employés attachés aux anciennes manières de faire et de penser. Démocratiser une entreprise demande du temps, et donc de l'argent. Cela suppose notamment de consacrer une part importante de la masse salariale à la formation. Cela peut induire des lourdeurs décisionnelles, car les choix doivent être faits en commun et entraînent souvent de longs débats, mais la mise en application est plus rapide, portée qu'elle est par l'enthousiasme des décideurs.
On peut également réfléchir au partage du travail et à l'aménagement du temps. Le but, aujourd'hui, n'est plus de « travailler dur » mais de travailler intelligemment. L'objectif de l'intra-entrepreneur, ce n'est pas de travailler plus mais de travailler mieux, et cela veut souvent dire travailler moins.
Ces différentes suggestions ne constituent en rien des recettes miracles. Mon expérience m'a prouvé que la détermination d'un dirigeant à démocratiser son entreprise a souvent plus d'importance que les moyens qu'il utilise pour y parvenir. On ne saurait, en revanche, transiger sur les principes qui doivent présider à cette démarche. Dans cette ère concertative, qui nous fait sortir de la culture du chef, les principes de liberté, de fraternité, d'égalité et d'acentralité doivent être au cœur de la réforme de l'entreprise. Ils ont déjà été mis en application à l'échelle macroéconomique, où les acteurs du marché sont dans la liberté de mouvement, dans la recherche de fraternité entre groupes pour éviter la concurrence à couteaux tirés, dans l'égalité des échanges marchands et dans l'acentralité, car aucun chef surplombant ne vient dicter leurs comportements. En ce sens, la logique macroéconomique est en avance sur la logique micro- économique de l'entreprise.
·
Au sein du Groupe Hervé, nous ne promouvons pas seulement la diversité culturelle, mais aussi la diversité générationnelle. Nous sommes convaincus, . parce que nous l'avons vu concrètement fonctionner, que les jeunes nouveaux font bouger les anciens, mais que la réciproque est aussi vraie. Plutôt que de bâtir des cloisons entre ces deux groupes générationnels, il faut au contraire multiplier les occasions de collaboration. Il faut également promouvoir la diversité géographique, sociale et ethnique, ainsi que l'emploi des personnes en situation de handicap.
Dans l'idéal, comme je le disais plus haut, la stratégie d'une entreprise devrait être définie par ses employés: l'entreprise devient alors ce que les salariés en font au gré de leurs désirs et des opportunités techniques ou commerciales. Nous devons être dans une logique effectuale (adaptation des fins aux moyens) plutôt que dans une logique prédictive (adaptation des moyens aux fins). C'est ce que j'appelle la méthode agile. Elle consiste, pour une entreprise, une équipe ou un individu, à s'adapter au fil du projet, en prenant en compte les signaux faibles et en étant à l'écoute des clients. Une telle méthode permet d'avancer pas à pas, de manière incrémentale, plutôt que de foncer tête baissée vers des objectifs prédéfinis par la direction.
C'est un autre aspect du principe de subsidiarité, auquel je tiens beaucoup: il faut laisser la décision aux opérateurs. Comme je le disais plus haut, ceux qui font sont ceux qui savent. Dans les sociétés du Groupe Hervé par exemple,
nous avons proposé à nos soudeurs et à nos chaudronniers d'aller voir le robot-soudeur que venait de commercialiser Air Liquide. Les soudeurs sont des professionnels qui tirent une grande fierté de leur savoir-faire. Suite à leur découverte du robot, ils ont décidé de l'adopter, notamment pour réduire la pénibilité de leurs tâches. Ils ont ainsi accepté d'être moins payés pour pouvoir s'offrir ce robot, et une fois qu'il a été installé, ils se sont redécouverts en travailleurs intellectuels.
S'ils ont pu faire ce chemin, c'est qu'ils avaient confiance en eux. La confiance en soi induit l'autonomie, la coopération et le plaisir de travailler en équipe. Elle favorise l'auto-évaluation et l'autocontrôle. En revanche, le manque de confiance en soi induit la peur de l'échec et le besoin d'appuis subsidiaires, en l'occurrence le manager catalyseur et le pair. La fausse confiance, quant à elle, conduit à une mauvaise évaluation du risque, au déni de ses erreurs, à la compétition, à la manipulation, au secret et à l'opacité. En situation de fausse confiance, les individus ont besoin de se rattacher à leur histoire et de se mentir en se disant : « vous vous souvenez quand on était les meilleurs, on avait gagné ceci et cela. » Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, cette attitude de repli sur son passé conduit à l'immobilisme et à l'aveuglement. À cet égard, la fausse confiance est beaucoup plus préjudiciable à l'entreprise que le manque de confiance en soi.
Laissez-moi vous raconter cette anecdote : j'ai mis très tôt des ordinateurs à disposition des ouvriers, notamment pour leur permettre de pouvoir émettre eux-mêmes leurs bons de commande. Ils étaient très fiers de disposer d'ordinateurs, et pourtant ils se cachaient dans leur voiture pour les utiliser. Intrigué par cette pratique, je me suis renseigné et j'ai découvert qu'ils faisaient ainsi parce qu'ils avaient l'impression qu'utiliser un ordinateur revenait à trahir la classe ouvrière. Quand ils se sont rendus compte que les autres ouvriers les enviaient, ils se sont mis à sortir leur ordinateur de leur voiture. Et l'obstacle qu'il a fallu désamorcer ensuite, ce furent les cadres du Groupe Hervé, pour lesquels la possession d'un ordinateur ne constituait plus un moyen de se rehausser vis-à-vis des opérateurs. Il nous a fallu alors leur rappeler qu'ils devaient tirer leur fierté du travail accompli, et non de leur équipement technique ou d'autres signes extérieurs de richesse.
Dans un cas comme dans l'autre, ce que l'on voit à l'œuvre, c'est de la fausse confiance. Un travailleur doit trouver de la fierté dans son travail et dans sa contribution au groupe, plutôt que dans la simple possession d'un objet ou d'un titre ronflant que les autres n'ont pas. C'est cette vanité et cette fausse confiance en soi qui débouchent sur la compétition, que nous avons dû vaincre hier avec les ouvriers et les cadres, et que nous continuons à combattre aujourd'hui car elles renaissent facilement.
Pis, dans certaines entreprises, c s comportements sont encouragés. On dit à chaque échelon qu'il vaut mieux que celui du dessous et moins bien que celui du dessus. On incite également les employés à assimiler leur fonction et leur salaire à leur poste, et non à leur contribution au collectif. On met l'accent sur les signes extérieurs de réussite, la gamme des voitures de fonction, la taille des bureaux, la marque du téléphone portable. Et surtout, on fait de la hiérarchie une fin en elle-même. Beaucoup de dirigeants qui ont entrepris d'« aplatir » leur pyramide hiérarchique m'ont confié à cet égard que nombre de salariés s'y opposaient, parce qu'ils avaient l'impression que cela remettait en cause leur identité même.
Lorsqu'on travaille dans des systèmes horizontaux, on n'a plus à craindre cela. Car, dès lors, ce n'est plus le sommet qui est le point de référence des identités et des fonctions, mais la manière dont chacun contribue à l'effort général, quels que soient sa place dans l'organigramme, ses diplômes ou le prix de son ordinateur.
Voilà, en résumé, comment les quatre principes cardinaux que j'ai identifiés comme formant le cœur de la nouvelle ère peuvent être mis en application pour transformer les entreprises. Vous l'aurez remarqué, ces principes font système et ne sauraient aller l'un sans l'autre. Par exemple, l'épanouissement personnel est tributaire de la solidarité et de la responsabilité; il ne peut y avoir de bien-être personnel sans bien commun ; pour pouvoir décider et être responsable, il faut être compétent et informé ; la participation, de même, favorise l'esprit d'équipe, la responsabilité et la compétence. La démocratisation d'une entreprise consiste ainsi· à tenir ensemble ces principes.
Enfin, et ce n'est pas sans importance, ces principes donnent des résultats : favoriser une plus grande autonomie des travailleurs, c'est accroître leur réactivité et leur proximité au client ; rehausser les compétences de chacun, c'est multiplier leur efficacité ; leur donner des responsabilités, c'est favoriser leur engagement et leur motivation; ; garantir une transparence totale, c'est augmenter la rapidité des déci sions ; et permettre aux employés de prendre soin d'eux et de leurs collègues, c'est accroître le bien-être et la résilience de tous. Les entreprises mettant en œuvre la démocratie concertative sont ainsi généralement plus innovantes et plus résilientes, et elles connaissent moins de jours d'arrêts maladie, moins d'accidents du travail et une plus forte croissance.
Pour autant, ne nous voilons pas la face : ce système démocratique peut avoir ses limites. Il impose parfois un changement complet de la culture de l'entreprise, ce qui ne va pas sans vives réactions de certains employés attachés aux anciennes manières de faire et de penser. Démocratiser une entreprise demande du temps, et donc de l'argent. Cela suppose notamment de consacrer une part importante de la masse salariale à la formation. Cela peut induire des lourdeurs décisionnelles, car les choix doivent être faits en commun et entraînent souvent de longs débats, mais la mise en application est plus rapide, portée qu'elle est par l'enthousiasme des décideurs.
On peut également réfléchir au partage du travail et à l'aménagement du temps. Le but, aujourd'hui, n'est plus de « travailler dur » mais de travailler intelligemment. L'objectif de l'intra-entrepreneur, ce n'est pas de travailler plus mais de travailler mieux, et cela veut souvent dire travailler moins.
Ces différentes suggestions ne constituent en rien des recettes miracles. Mon expérience m'a prouvé que la détermination d'un dirigeant à démocratiser son entreprise a souvent plus d'importance que les moyens qu'il utilise pour y parvenir. On ne saurait, en revanche, transiger sur les principes qui doivent présider à cette démarche. Dans cette ère concertative, qui nous fait sortir de la culture du chef, les principes de liberté, de fraternité, d'égalité et d'acentralité doivent être au cœur de la réforme de l'entreprise. Ils ont déjà été mis en application à l'échelle macroéconomique, où les acteurs du marché sont dans la liberté de mouvement, dans la recherche de fraternité entre groupes pour éviter la concurrence à couteaux tirés, dans l'égalité des échanges marchands et dans l'acentralité, car aucun chef surplombant ne vient dicter leurs comportements. En ce sens, la logique macroéconomique est en avance sur la logique micro- économique de l'entreprise.

 Accueil
Accueil Ligne éditoriale
Ligne éditoriale




 4.76 Sortir de la culture du chef ? par Michel Hervé PDG du Groupe Hervé
4.76 Sortir de la culture du chef ? par Michel Hervé PDG du Groupe Hervé




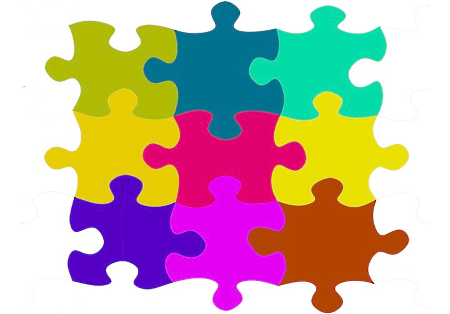
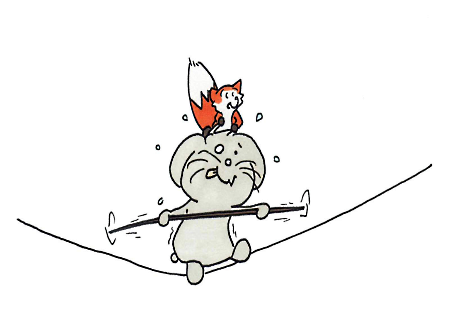





 Accueil
Accueil